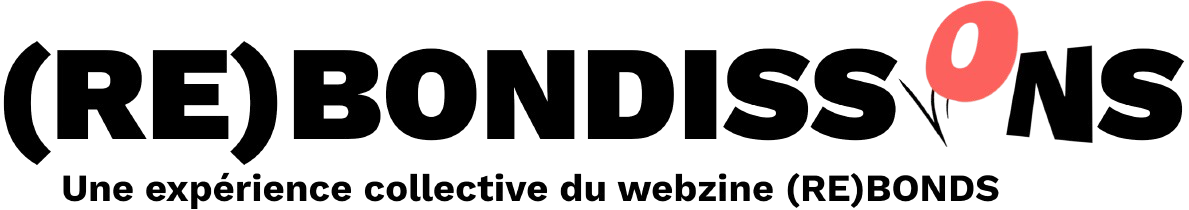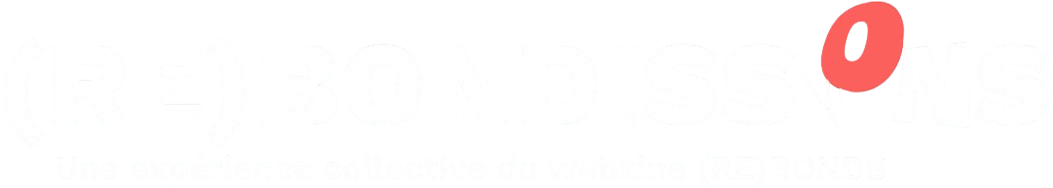A Bourges, la mairie veut visibiliser la migration féminine
« Le déclic ? C’est la rencontre avec l’association Mémoires Plurielles (1) qui propose une exposition intitulée « Migrer au féminin ». Nous l’accueillons à Bourges. Nous avons décidé de la relier avec l’histoire de la ville, en l’enrichissant de témoignages de femmes vivant ici. » Marie-Hélène Biguier est conseillère municipale déléguée à l’intergénérationnel et travaille ainsi depuis plusieurs années sur la question de la transmission. « Notre idée était de faire des portraits, précise-t-elle, et à travers eux, de raconter l’histoire de la migration au féminin à Bourges mais aussi, ce que ces femmes transmettent aux autres générations et ce qu’elles apportent au pays. »
Pour l’accompagner dans sa démarche, la mairie de Bourges a accueilli en stage Mina Pavy, étudiante en Master 2 Sociologie à l’université de Tours. Bourges est devenu son terrain d’études, puis elle a rédigé un mémoire. Son objectif n’était pas de réaliser un état des lieux exhaustif de la migration féminine à Bourges mais plutôt de questionner la démarche de la mairie : de quelle manière une telle institution s’empare-t-elle du sujet ?
Des parcours très variés
Mina Pavy a d’abord effectué des recherches de contexte historique et sociologique. S’il n’existe pas de données précises sur Bourges, celles du Centre de la France apportent des éléments. L’immigration ne constitue pas un élément clé de l’histoire de la région, mais elle est un phénomène constant et mouvant du développement économique et démographique local (2). Les personnes immigrées représentent aujourd’hui 5,5 % de la population (3 % dans les années 1960). Russes, américaines, polonaises, espagnoles, portugaises, italiennes, arméniennes, maghrébines, turques, cambodgiennes, laotiennes, vietnamiennes, rwandaises, kosovares, afghanes… elles sont de pays très variés.

Les raisons de leur venue sont diverses aussi : des Polonais·e·s qui travaillent dans les usines aux Algérien·ne·s qui répondent au besoin de main d’œuvre en agriculture, en passant par les Espagnol·e·s chassé·e·s de leur pays par la guerre civile et les Américain·e·s présent·e·s sur les bases militaires… 70% des immigré·e·s de la région vivent aujourd’hui dans l’Indre-et-Loire, le Loiret et l’Eure-et-Loir, les départements situés sur l’axe ligérien, les plus proches d’Ile-de-France, et les plus urbanisés et peuplés de la région.
Déconstruire les stéréotypes
Qu’en est-il des femmes ? Longtemps invisibilisée, la migration féminine fait l’objet « d’un intérêt accru ces dernières années », selon Mina Pavy. « Si nous nous intéressons à la situation contemporaine de la migration internationale, il est bon de noter que le pourcentage d’hommes et de femmes n’a pas évolué, comme pourrait le laisser croire la notion de féminisation des flux migratoires, mais que ce sont les formes de migrations féminines qui se sont modifiées. Les femmes migrent de manière plus indépendante, à la recherche d’emploi, comme principal soutien pour la famille et comme pionnières de la migration en ne suivant plus seulement les hommes. »
Ainsi, si la part des femmes varie selon les populations concernées ou les périodes, elles ont toujours été présentes dans les flux migratoires. Pour Mina Pavy, « l’absence des femmes migrantes [dans les études] ne semble pas étonnante au regard de tous les autres domaines de recherches où les femmes sont restées dans l’ombre pendant longtemps ».
De plus, le regard porté sur les femmes immigrées en France semble avoir du mal à évoluer : dans les médias et l’imaginaire collectif, elles sont généralement considérées comme victimes de culture, passives, à protéger. La chercheuse Mirjana Morokvasic (3) à laquelle se réfère Mina Pavy « dénonce le peu de recherches sur les migrantes en tant qu’entrepreneuses, femmes qualifiées, ou comme figures majeures des mouvements et luttes sociales ». « Les sujets auxquels elles sont encore associées restent réducteurs, comme celui de la famille ou du secteur des soins. »
L’enjeu est donc de visibiliser les femmes mais aussi de déconstruire des stéréotypes.
Une posture d’observation participante
De septembre à décembre 2022, Mina Pavy a travaillé sur le terrain : elle a assisté aux ateliers d’écriture organisés par la Ville de Bourges pour faire advenir la parole des femmes. Dix-huit âgées de 28 à 90 ans ont participé. Elles sont arrivées en France à des époques très différentes, des années 1970 à aujourd’hui (une seule est née en France). Pour les choisir, Marie-Hélène Biguier s’est adressée aux associations d’amitié culturelle (mais sans grand succès), et à ses propres réseaux de connaissances. « Notre objectif était d’avoir des personnes de tous les quartiers », souligne-t-elle. Les nationalités représentées étaient variées : Equateur, Albanie, Angola, Guinée, Laos, Vietnam, Algérie, Pologne, Portugal, Egypte, Congo Kinshasa, Madagascar, Espagne, Pérou.

Animés par une professionnelle, Yvette Moulin, seize ateliers d’écriture se sont déroulés en non-mixité, durant deux heures chacun. Toutes les femmes parlaient et écrivaient le français. Mina Pavy s’est placée en situation d’observation participante, une posture sociologique validée. « Je ne pouvais pas faire qu’observer sans prendre part, explique-t-elle. Je n’avais pas pris conscience que j’étais vraiment concernée. Mon grand-père paternel a migré du Liban en France. Je ressens une grande attache à ce pays même si je n’y suis jamais allée. Je n’ai pas vécu moi-même le parcours migratoire, mais les ateliers m’ont interrogée sur mon propre sentiment d’appartenance et sur la transmission au sein de ma famille. Ça m’a rattrapé, c’était touchant. »
« Entre deux mondes »
En livrant son histoire, sa participation active lui a permis de nouer une relation de confiance forte avec les autres femmes. Un plus pour l’étape suivante : les entretiens semi-conductifs individuels. Mina Pavy a interrogé neuf femmes sur les thèmes du parcours de migration, du sentiment d’appartenance et de la transmission.
Quels points communs a-t-elle pu relever ? « Les parcours migratoires ne sont pas linéaires, ils ne suivent pas un chemin tracé définitivement du départ à l’arrivée. Il y a une évolution en fonction des contraintes extérieures administratives, économiques, sociales, et en fonction des rencontres, des relations. » Pour surmonter les épreuves, les femmes ont toutes mis en œuvre des savoirs et des ressources propres à leur situation. Elles sont agissantes, elles ne se cantonnent pas à la passivité. C’est ce que la sociologie appelle le « savoir-migrer » et le « savoir rester ». Il peut s’agir de constituer des réseaux, prendre les habitudes d’un pays, apprendre, s’adapter…
Le sentiment d’appartenance est très subjectif mais là aussi, Mina Pavy a relevé un point commun entre toutes les femmes interrogées : l’importance des relations familiales. « Le sentiment d’appartenance est moins ses attaches à un pays, à un sol qu’à des relations familiales, amicales. » Certaines lui confient se sentir être « entre deux mondes », particulièrement lorsqu’elles rentrent ponctuellement dans leur pays d’origine. « Elles sont sans cesse renvoyées, en fonction des situations, soit à leur condition d’émigrées ayant quitté le pays de départ, soit d’immigrées arrivant dans un nouveau pays, écrit Mina Pavy dans son mémoire (…). Ce retour ponctuel affecte la manière dont elles sont perçues par les personnes qui sont restées au pays. En effet, elles me racontent toutes que ce regard extérieur porté sur elles les fait se sentir étrangères, bien qu’elles soient nées et aient vécu sur place. »
Une transmission sélective et discontinue
Au cœur de la démarche de la Ville de Bourges comme du travail de Mina Pavy, la transmission entre les générations. L’étudiante en sociologie a participé à un atelier « Pains du monde » en octobre 2022 organisé à l’occasion de l’opération « Itinéraires solidaires » à Bourges, avec le RECHO (4). Martha, équatorienne ayant vécu en Pologne avant d’arriver en France, a transmis sa recette de pain traditionnel aux participant·e·s à l’atelier (parents, enfants, grands-parents...) ; le lendemain, c’est Adana et Belina, mère et fille originaires d’Albanie, ainsi qu’Inès, d’origine algérienne, qui ont partagé leur savoir-faire.

Suite aux entretiens qu’elle a menés, Mina Pavy explique que la transmission est souvent « sélective et discontinue » : elle se fait soit lors de moments extraordinaires tels que cet atelier, soit dans le quotidien mais sans modalités particulières. Les expériences sensibles, concrètes (comme la cuisine) sont préférées à un savoir théorique constitué.
De plus, la transmission est symbolique : « Il ne s’agit pas de transmettre des biens mais plutôt une culture, un sentiment d’appartenance. » Elle permet aux femmes concernées de se référer à des souvenirs, points de repère essentiels dans un processus bouleversant comme la migration, et de les transmettre. Ce réflexe est parfois vécu par les habitant·e·s « natif·ve·s » comme un repli sur une culture d’origine, mais il est souvent indispensable pour ne pas perdre pied.
Un projet qui se prolongera ?
Diplômée depuis le mois de septembre, Mina Pavy sera de retour à Bourges le lundi 18 décembre à l’occasion du vernissage de l’exposition « Migrer au féminin, partir, rester, se souvenir ». « J’y présenterai surtout le processus de mon travail », précise-t-elle. Son but était d’expliquer la manière dont la Ville de Bourges s’empare du sujet de la migration féminine et la valorise. Malgré les contraintes (financements, validation...), « les organisatrices trouvent des marges de manœuvre pour développer un projet qui permette aux femmes de rester en possession de leurs paroles, et de participer autant que possible à sa construction ».
Elles ont retravaillé les textes des ateliers d’écriture pour les présenter et des portraits de femmes berruyères ayant participé feront partie de l’exposition.
De son côté, Marie-Hélène Biguier espère que le projet de valorisation pourra se prolonger et s’inscrira, lui aussi, dans la durée, dans l’histoire de la ville.
Texte : Fanny Lancelin
Photos : Mina Pavy, Marie-Hélène Biguier
Notes
- (1) https://www.memoires-plurielles.org/
- (2) Ces données recueillies Mina Pavy sont issues du livre « Etrangers dans le berceau de la France ? L’immigration en région Centre du XIXème siècle à nos jours » dirigé par Hélène Bertheleu, Sylvie Aprile et Pierre Billion, et de l’article associé « Faire l’immigration en région Centre : un début », publié dans la revue Hommes et migrations.
- (3) « La visibilité des femmes migrantes dans l’espace public » (article publié dans la revue Hommes et migrations, 2015), Mirjana Morokvasic.
- (4) Lire l’article de (Re)bonds consacré à cet événement : http://archives.rebonds.net/63agirpourplusdejusticealimentairenov2022/813-lacuisinecommeespacederencontresentrepopulatins.html