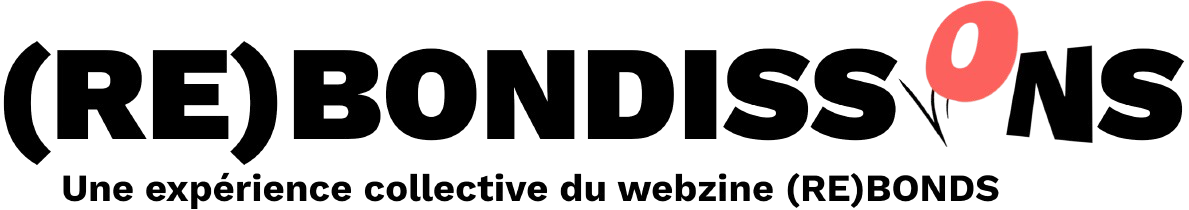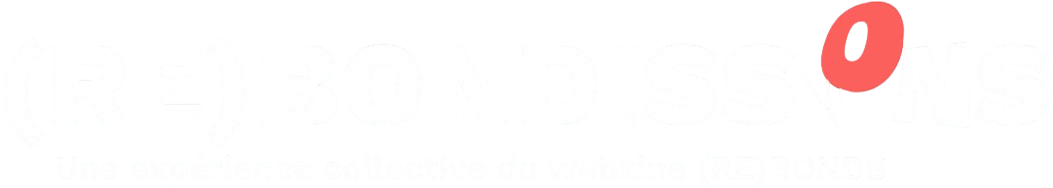Des associations contre la nouvelle loi Immigration
Le projet de loi « Pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » vient d’être voté au Sénat par 210 voix pour et 115 voix contre. A partir du 11 décembre, il passera devant l’Assemblée nationale puis sera adopté. Pas de navette parlementaire, pas d’allers-retours entre les deux chambres : le gouvernement a engagé une procédure accélérée afin de faire voter la loi définitivement avant la fin de l’année.
Le sujet est particulièrement clivant. A tel point que le gouvernement l’avait retiré de l’ordre du jour des débats parlementaires en mars, se donnant quelques mois supplémentaires pour convaincre sa majorité. Les partis de droite ne le trouvaient pas assez dur ; ceux de gauche fustigeaient ses dispositions ultra répressives. Quant aux associations de défense des droits des personnes étrangères, elles dénonçaient « des mesures insuffisantes, dangereuses et contre-productives » (1).
Dans le Centre de la France, et notamment à Bourges où un groupe local de la Cimade a récemment vu le jour et où une coordination pour le droit d’asile est active depuis 2015, des bénévoles se mobilisent pour alerter sur les atteintes aux droits des personnes étrangères.
Que contient cette loi ? Quelles dispositions dégradent particulièrement ces droits ? Comment les associations peuvent-elles réagir et peser dans les débats ?
« L’immigration ne va pas s’arrêter »
Créée en 1939 par les mouvements de jeunesse protestants, aujourd’hui association indépendante et laïque, la Cimade (2) agit depuis près de 85 ans pour défendre les personnes déplacées, réfugiées, migrantes jusque dans les camps d’enfermement pendant et après les guerres (mondiale, d’Algérie, d’Indochine…), et les Centres de Rétention Administrative (CRA) aujourd’hui.
Progressivement, à mesure que les politiques migratoires se durcissent et se complexifient, elle a mis en place un accompagnement juridique, mais aussi un véritable plaidoyer : elle n’hésite pas à dénoncer publiquement le sort réservé aux réfugié·e·s en France et analyse méticuleusement les projets de loi pour construire des alternatives.

C’est ainsi que pour la loi de 2023, elle propose un décryptage intitulé « Non à la loi asile et immigration - ni précarité, ni expulsions - régularisation ! » (3)
« Chaque loi empile de nouvelles restrictions, explique Guillaume Marsallon, salarié de la Cimade, délégué en région Centre-Ouest. On laisse penser que grâce à cette loi, les personnes étrangères ne seront plus là demain matin. Mais c’est faux : l’immigration ne va pas s’arrêter, elle fait partie de l’histoire de l’Humanité. Alors, est-ce qu’on maintient ces personnes dans une situation de précarité ou est-ce qu’on change d’optique en leur permettant de vivre décemment ? C’est ça, la véritable question, le véritable enjeu. »
De son côté, la Coordination du Berry pour le droit d’asile par la voix de Dominique Géliot, l’une de ses membres, dénonce « les débats épouvantables » qui se sont tenus au Sénat. « D’une inhumanité inconcevable ! » Créée en 2015 à Bourges, la Coordination est un collectif regroupant des associations et des particulier·e·s qui œuvrent pour le respect des droits des personnes étrangères.
Comment régulariser les travailleur·se·s sans-papiers ?
Le projet de loi contient plusieurs volets.
Pour le travail, elle prévoyait de créer une carte de séjour d’un an mention « Travail des métiers en tension », selon une liste de métiers dressée par l’Etat « pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs comme le bâtiment, l’aide à domicile... » (4)

Les associations pointaient du doigt le caractère éphémère du titre de séjour (un an seulement) sans qu’aucune solution durable ne soit prévue ensuite. Elles réclament la régularisation de tous les sans-papiers sans exception ni discrimination. « Nous avons déjà tous les textes qu’il faut pour les régulariser, assure Dominique Géliot, membre de la Coordination du Berry pour le droit d’asile. La circulaire Valls est dans les mains des préfets. Mais ils ont sûrement des consignes pour ne pas régulariser trop. » En 2012, la circulaire Valls a donné aux préfectures le pouvoir de régulariser les sans-papiers, pourvu qu’iels aient travaillé de 8 à 30 mois, qu’iels aient une promesse d’embauche de leur employeur·se et qu’iels aient vécu en France depuis au moins 3 ans.
L’article initial (article 3) proposé par le gouvernement a donné lieu à de vifs débats au Sénat et a finalement été supprimé au profit d’un nouvel article, beaucoup plus dur, ne répondant pas du tout aux objections des associations : en effet, ce n'est qu'à « titre exceptionnel », et non plus de plein droit comme le prévoyait le gouvernement, qu'un·e travailleur·se pourra prétendre à la régularisation. A condition d'avoir exercé pendant au moins douze mois sur les deux dernières années dans des « métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement » (selon les termes de l’article 4 bis).
La délivrance de la carte de séjour « serait en outre conditionnée à un examen par l'administration de la réalité et de la nature des activités professionnelles de l'étranger, de son insertion sociale et familiale, de son respect de l'ordre public, de son intégration à la société française, à ses modes de vie et à ses valeurs, ainsi que de son respect des principes de la République ».
En revanche, plus besoin de promesse d’embauche de l’employeur·se : la personne étrangère pourra faire elle-même la demande de sa régularisation.
L’article sera-t-il validé ainsi à l’Assemblée nationale ? « Nous rétablirons le texte ambitieux de l’exécutif », a déjà prévenu Sacha Houlié, député Renaissance. De nouveaux débats en perspective.
Les étranger·e·s assimilé·e·s à des délinquant·e·s
Pour obtenir une première carte de séjour, les exigences quant à la langue française sont rehaussées, notamment à l’écrit, alors que les centres de formation sont déjà saturés voire totalement absents de certains territoires.
« Le respect des principes de la République » devient une autre condition sine qua non à l’attribution ou au renouvellement d’un titre de séjour. Le texte cite pêle-mêle l’égalité hommes-femmes, la devise et les symboles de la République.
Mais il appuie surtout sur « la menace grave contre l’ordre public ». « Par l’utilisation de certains termes, on assimile systématiquement les étrangers à des délinquants, souligne Guillaume Marsallon. Mais en fait, toutes les personnes étrangères sont visées. »
Aujourd’hui, si l’administration, par le biais de ses préfectures, considère que le comportement d’un·e individu·e étranger·e constitue une menace, elle a la possibilité de prononcer un arrêté d’expulsion. Problème : la procédure est longue. Le projet de loi entend donc la simplifier en transformant l’arrêté en Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) beaucoup plus rapide à mettre en œuvre.
Les reconduites à la frontière seraient possibles y compris pour des personnes arrivées mineures ou pour des conjoint·e·s de Français·e·s.
Les dispositions du texte adopté au Sénat visent les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, ou lorsqu’il s’agit de violences intra-familiales. Des mesures qui peuvent être assorties d’une interdiction du territoire français pour dix ans.
Mais la Cimade dénonce une « notion de menace à l’ordre public trop floue », et le risque de briser des parcours familiaux et sociaux sur de simples suspicions.
Des mineur·e·s toujours enfermé·e·s
Avant d’être expulsées, les personnes en situation irrégulière passent souvent par des CRA, des Centres de Rétention Administrative. En 40 ans (les CRA ont été officialisés par la gauche en 1981), la durée légale de rétention est passée de 7 à 90 jours.
Les mineur·e·s ne sont malheureusement pas à l’abri de cet enfermement. « La France a été condamnée onze fois par la Cour Européenne des Droits de l’Homme », rappelle Dominique Géliot, pour ce traitement jugé « inhumain et dégradant ». Malgré cela, depuis 2012, 35.000 enfants ont été enfermé·e·s en CRA.

Que prévoit la nouvelle loi ? Elle réaffirme la possibilité d’enfermer les jeunes de 16 à 18 ans s’iels sont accompagné·e·s d’un adulte. Plus de CRA pour les moins de 16 ans (sauf celleux de l’outre-mer) mais des LRA, Locaux de Rétention Administrative, généralement situés dans les commissariats. « Les droits prévus en LRA sont encore plus limités », regrette la Cimade. Pas d’unité médicale ou d’accompagnement juridique et surtout, pas de statistiques, invisibilisant ainsi le sujet… Quant à la distinction d’âge, la Cimade rappelle que la France, en signant la Convention internationale du Droit des enfants, s’est engagée à protéger tou·te·s les mineur·e·s, quel que soit leur âge.
L’aide médicale supprimée
Autre atteinte grave qu’entérinerait la nouvelle loi : la suppression de l’Aide Médicale d’Etat (AME). A l’origine, le gouvernement ne l’avait pas prévue, même si Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur qui porte cette loi, y était favorable. C’est le parti Les Républicains (LR), qui juge le système de santé trop généreux avec les sans-papiers, qui a profité de sa position de force au Sénat pour supprimer l’AME et la remplacer par une aide médicale d’urgence. L’idée est-elle de faire des économies ? De petites économies alors, l’AME représentant 0 ,4 % de l’ensemble des dépenses de santé en France et la moitié des personnes qui y ont droit ne la demandant pas.
En revanche, du point de vue de la santé publique, la disposition semble aberrante. « L’aide médicale d’urgence est une couverture extra minimale où tout l’aspect prévention disparaît », prévient Guillaume Marsallon. Au final, le coût risque d’être plus élevé, une prise en charge tardive des maladies nécessitant plus de soins. « Les médecins sont unanimement contre (5), rappelle Dominique Géliot. C’est un non-sens en terme de santé publique. Et que vont faire les personnes concernées lorsqu’elles seront malades ? Elles iront encore plus encombrer les urgences ! »
Par ailleurs, deux plaintes pour non-respect du serment d’Hipocrate ont été déposées contre des sénateur·ice·s médecins par des confrères (6).

De son côté, la Cimade dénonce aussi la dégradation du droit au séjour pour raison de santé. Lorsqu’un traitement n’est pas accessible dans un pays, mais qu’il l’est en France, il est possible d’être accueilli·e ici pour être soigné·e.
Le projet de loi supprimerait certains critères : si le traitement existe dans un pays, même s’il n’est pas accessible pour des raisons économiques par exemple, il ne serait plus possible d’obtenir le titre de séjour.
Mais la France irait alors à l’encontre de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui souligne que les Etats-membres doivent tenir compte de la possibilité effective pour l’intéressé·e d’avoir accès à ces soins et équipements dans son pays d’origine.
« Si les politiques faisaient de la pédagogie... »
Que peuvent faire les associations pour peser dans les débats ? Au printemps, la Coordination du Berry pour le droit d’asile et la section locale de la Ligue des Droits de l’Homme ont animé une conférence pour sensibiliser le public au projet de loi.
La Coordination a rencontré les députés du Cher (Renaissance, LR et Nupes). Les deux sénateur·ice·s (LR) ont refusé.
Dominique Géliot interroge : « En quoi la présence d’étrangers nuirait-elle à la vie des Français ? Si les étrangers quittaient le territoire, la vie des Français ne serait pas meilleure : ils n’auraient pas plus de revenus, pas plus de vacances, pas une retraite plus tôt non plus ! » Alors que le gouvernement ne cesse de parler de « pédagogie », elle aimerait qu’il joue son rôle dans l’acceptation de tous·te·s les étrangèr·e·s selon le principe d’égalité constitutive de notre devise : « Pour les Ukrainiens, il n’y a pas eu de problème. Alors, pourquoi pas les autres ? Cet exemple prouve bien que si les politiques faisaient de la pédagogie, nous serions beaucoup plus accueillants. »
Des pressions sur les associations
Mais le jeu de l’Etat n’est pas clair et il n’aime pas les voix discordantes.
En affirmant haut et fort son opposition à la loi, la Cimade joue le rôle qui est le sien depuis des décennies : défendre les droits des personnes étrangères ; dénoncer publiquement les atteintes à ces droits ; formuler des propositions ; et sensibiliser la population à ces questions.
Une liberté de ton qui ne plaît pas toujours, comme en témoignent les relations tendues que la Cimade a entretenues avec le ministère de l’Intérieur en 2008 et 2009, notamment au moment du débat sur « l’identité nationale » lancé par Eric Besson. Pour la punir, alors qu’elle était la seule à entrer dans les CRA, l’Etat a voulu l’en écarter en ouvrant le « marché » à d’autres associations, obligeant la Cimade à un plan social collectif.
Les relations avec le ministère de l’Intérieur actuel ne sont pas meilleures. Guillaume Marsallon évoque « une dérive très inquiétante » : « l’Etat exerce de plus en plus de pressions sur les associations qui ont une voix discordante. Soit on nous condamne publiquement pour notre positionnement, soit on réduit nos financements. »
La Cimade s’est ainsi vue accusée d’avoir soutenu la famille du tueur présumé de Dominique Bernard, enseignant à Arras, à l’époque où cette famille était menacée d’expulsion en 2014. Et ainsi, d’avoir indirectement permis le meurtre… « La Cimade refuse de faire le lien entre ce drame et la mobilisation intervenue il y a 10 ans au nom du respect des droits d’une famille », ont déclaré les responsables de la Cimade dans un communiqué de presse (7). L’association entend « tenir bon contre la déraison et la spirale de la haine ».
Guillaume Marsallon constate ce « glissement très très fort depuis trois ou quatre ans ». « Il est encouragé par le ministère de l’Intérieur, des éditorialistes… Le discours du gouvernement active des actes : derrière, c’est toute la fachosphère qui se déchaîne. »
Selon lui, « la démocratie, c’est aussi accepter de financer des voix discordantes ». « Notre place est indispensable à la santé démocratique de notre pays. »
Ainsi, la Cimade continuera à veiller sur les droits et la dignité des personnes d’où qu’elles viennent. De nouveaux décryptages de la loi sont prévus sur son site jusqu’à la fin des débats à l’Assemblée nationale.
Fanny Lancelin
Notes
- (1) https://www.lacimade.org/analyse/projet-de-loi-asile-et-immigration-2023/
- (2) Pour Comité Inter Mouvement Auprès Des Evacué·e·s.
- (3) https://www.lacimade.org/analyse/projet-de-loi-asile-et-immigration-2023/
- (4) https://www.vie-publique.fr/loi/287993-projet-de-loi-immigration-integration-asile-2023
- (5) https://actu.fr/societe/les-medecins-denoncent-la-suppression-de-l-ame-doit-on-les-laisser-crever-comme-des-betes_60313283.html
- (6) https://www.ouest-france.fr/societe/immigration/sans-papiers/suppression-de-lame-deux-plaintes-contre-des-medecins-senateurs-lr-devant-lordre-des-medecins-2fb0314a-7fbc-11ee-a407-397218b61e71
- (7) https://www.lacimade.org/tenir-bon-ensemble-contre-la-deraison-et-la-spirale-de-la-haine/
Plus
La Cimade à Bourges
La Cimade compte 96 groupes locaux dans l’hexagone et en outre-mer. Celui de Bourges a été créé en 2021 à l’initiative d’Emmanuelle Poyau.
Isabelle Besnainou l’a rejoint quelques mois plus tard. « Je connaissais déjà la Cimade par mon travail : je suis enseignante de FLE, Français Langue Etrangère. Je cherchais alors des informations sur le droit des personnes étrangères. »
Née en France, Isabelle a vécu 28 ans au Mexique avant de revenir dans son pays d’origine. « J’estime que chacun·e doit pouvoir vivre où iel veut. Comme le dit le slogan de la Cimade, il n’y a pas d’étrangers sur cette terre. Que des êtres humains. »
Aujourd’hui trésorière du groupe local de Bourges, elle a reçu une formation donnée par le délégué régional, Guillaume Marsallon. Elle bénéfice aussi des nombreuses ressources de la plateforme de la Cimade dédiée aux bénévoles.

Quelles sont les missions d’un groupe local ? « Normalement, l’aide juridique en fait partie. Mais ça demande beaucoup de temps, notamment pour se former et pour accueillir les personnes. Pour l’instant, nous avons décidé de nous concentrer sur la sensibilisation du public. Nous voulons faire connaître la situation des personnes étrangères aux habitant·e·s de Bourges et des environs. »
Depuis 2022, l’équipe locale organise le festival Migrant’Scène dans le Cher. Cette année, trois films seront projetés :
- « Shadow Game » de Eefje Blankevoort et Els van Driel, vendredi 17 novembre à 19 h 30 à l’Antidote à Bourges. Prix du Meilleur documentaire au Festival international du film sur les Droits Humains de Genève. Une plongée en apnée avec les jeunes migrants qui tentent de rentrer en Europe.
- « La brigade » de Louis-Julien Petit, dimanche 19 novembre à la Biocoop « Au bourgeon vert », salle 121 à Bourges. Une femme qui se rêve cheffe cuisinière se retrouve cantinière dans un foyer pour jeunes mineurs non accompagnés. Elle décide de s’engager au maximum pour l’inclusion de ces jeunes dans la société française.
- « Les Echappées » de Katia Jarjoura, vendredi 24 novembre à 19 h, salle communale du Noyer, avec la participation de la chorale « Le cri du samedi ». De Paris à Oslo, de La Palma à Istanbul, cinq jeunes artistes syriennes contraintes de fuir leur pays racontent leur trajectoire brisée et leur révolution personnelle. Un film choral !
Pour joindre le groupe local de Bourges de La Cimade : bourges@lacimade.org
Pour plus d’informations sur le festival Migrant’Scène : https://www.migrantscene.org/
Photo (I.B.) : Isabelle Besnainou entourée de Ihsan qui vient du Soudan et Hindiya, femme kurde originaire de Syrie, sur le stand de la Cimade lors du forum des associations à Bourges.