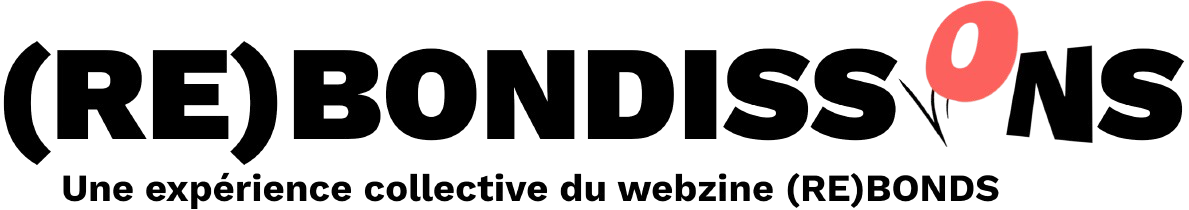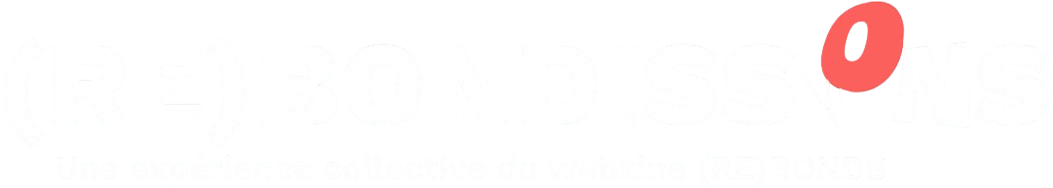K. : du Congo à la France, itinéraire d’un exil - La force en héritage
Je m'appelle K.
Je suis née en République Démocratique du Congo (RDC), au Katanga, une province au sud est, dans la ville de Lubumbashi. Je suis la cadette d’une famille de neuf enfants, originaire de la province du Kasaï.
Mon père était médecin dans une entreprise minière, Gecamines (1), qui se trouve dans la ville de Lumbubashi.
Il était issu d'une famille noble et ma mère d'une famille de chasseurs. Le souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il travaillait beaucoup. Quand il rentrait, il y avait devant chez nous, une queue de personnes qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'hôpital. Il avait une sorte de dispensaire à la maison. Moi, j'étais tout le temps là ; j'attendais que la queue s'épuise pour passer un peu de temps avec lui.
Ma mère était instructrice à l'école mais je crois qu'elle a arrêté à ma naissance pour s'occuper de sa famille. Elle avait aussi des activités politiques ; il y avait des réunions qui se passaient à la maison. Elle prenait soin des personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens.
En 1992, la guerre tribale entre les Katangais et les Kasaïens a éclaté. Moi, j'avais 7 ans. Les Katangais ne voulaient plus des Kasaïens dans leur région parce qu'ils les accusaient de prendre leur territoire, leur travail...
Nous, on était Kasaïens donc on nous a obligés à partir et ceux qui ne voulaient pas étaient abattus sur place. On était obligé de tout laisser. On n'a rien pris.

« J’ai vécu des horreurs, le plus dur de ma vie... »
En sortant de la maison, j'ai vu les cadavres de mon père, de ma sœur et de quatre de mes frères.
Avec ma mère, on s’est d’abord réfugié dans un camp pour partir au Kasaï. Mais ma mère est allée chercher mes trois autres frères. Elle m’a laissée dans le camp en disant de l’attendre, qu’elle allait revenir.
C'est la dernière fois que je l'ai vue.
Ma mère et trois de mes frères sont toujours portés disparu.e.s à ce jour.
Je suis restée dans le camp des jours et des jours à attendre. Il y avait plein d'autres personnes. Mais moi, j'étais seule.
J'ai beaucoup pleuré. Je n’ai jamais pleuré autant.
J'attendais. J'avais toujours l'espoir de retrouver ma mère. C’est la Croix Rouge qui m’a prise en charge.
Finalement, j'ai dû prendre un train pour le Kasaï. Dans ce train de marchandises, il y avait beaucoup de monde, de malades, de morts. Le voyage a duré longtemps, très longtemps. J’ai vu des gens mourir devant moi. J’ai vu des femmes accoucher. Les cadavres des bébés étaient jetés par la fenêtre. On n’avait même plus la force de pleurer. On ne mangeait rien.
Au Kasaï, je me suis retrouvée dans une maison d’accueil. J’avais toujours l’espoir de retrouver ma mère.
Il y avait dans cette maison une femme qui amenait des hommes pour me violer. J'ai vécu des horreurs, le plus dur de ma vie… C’était le cauchemar.
A 15 ans, je suis tombée enceinte. J'ai accouché de ma fille. Elle m'a été arrachée.
J’ai finalement décidé de fuir cette maison.
J'ai erré partout. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour aller à l'école. J'ai essayé de me reconstruire. J'ai été recueillie par une famille. Je vendais des gâteaux dans la rue le matin et j'allais l'après-midi à l'école publique.
« C’était vraiment une question politique »
Notre professeur d'Histoire nous a expliqué pour la première fois la vérité sur ce qui c'était passé dans les années 1990, quand ma famille a dû quitter le Katanga. A l'époque, le président était Mobutu, un grand dictateur qui est resté 32 ans au pouvoir. Il faisait face à une forte opposition, dont le leader Etienne Tshisekedi était kasaïen. Mobutu avait voulu éliminer ses opposants, en déclenchant la guerre tribale. (2)
Ma mère était partisane de l'opposition et soutenait Tshisekedi, c'est pour ça que mes parents ont été ciblé.e.s.
Je n'avais jamais compris pourquoi mon père avait été tué par des gens qu'il avait aidés ; ça devenait soudain plus clair. C'était vraiment une question politique.
Il y a eu beaucoup de morts dans les années 1990. Mais le parti de Tshisekedi n'en a jamais parlé. Ça me choquait. A l'époque, je m'interrogeais : soit c'était pour avoir une sorte de paix, soit c'est parce qu'ils étaient complices. Mais je ne pouvais pas avoir confiance, je ne pouvais pas les soutenir.
Et puis, lorsque j'ai eu 23 ans, j'ai entendu parler du gouverneur de la région du Katanga, Moïse Katumbi. Même si j'étais partie, je m'intéressais toujours à ce qui se passait dans ma région d'origine. C'est le seul qui tenait un discours public en parlant haut et fort de ce qui s'était réellement passé. Il parlait de rebâtir sur de nouvelles bases, tous ensemble. Il parlait d'unité. C'était le seul qui tenait ce genre de propos. C'est là que des petits groupes de soutien au gouverneur ont commencé à se créer : c'était le mouvement katumbiste.
Je suis entrée dans ce mouvement. Le but était de partager des informations et des connaissances, de soutenir les idées du gouverneur mais aussi de se faire entendre de lui. On vivait au Kasaï, on avait été chassé.e.s du Katanga. On voulait lui dire : on a envie de pouvoir revenir pour rebâtir, mais on n'est pas les bienvenu.e.s chez toi, comment on fait ?
Mais ça provoquait des tensions : beaucoup de gens ne comprenaient pas qu'on le soutienne parce qu'ils considéraient les Kantangais, et donc Moïse Katumbi, comme responsables du génocide.
Je suis partie du Congo en 2013, parce que ça devenait de plus en plus dangereux. J'étais menacée de mort. J’ai reçu des insultes, j’ai été battue.

« Je pensais qu’en France, j’allais me sentir en sécurité »
Des amis m'ont aidée.
Je suis allée à Libreville, au Gabon. J’avais 29 ans.
J’y ai rencontré le père de mon fils. Mais, me considérant comme une étrangère, la famille de cet homme s’opposait à notre union. Il m’a quittée.
Quelques temps après, j’ai rencontré quelqu’un qui a pris en charge mon enfant. Mais notre relation est devenue toxique : coups, viols, violences extrêmes qui m’ont fait perdre un autre enfant que j’attendais...
Cet homme était colonel et travaillait avec les fils de Omar Bongo (3). C’était dangereux. Une seule solution s’offrait à moi : partir, fuir.
Des gens m'ont aidée. Ils m'ont fait un faux passeport gabonais avec une fausse identité et un visa ; ils ont payé le billet d’avion et je suis arrivée en France avec mon fils.
Pour moi, la France, c'est le pays des Droits de l'Homme. Après tout ce qui m'était arrivé dans la vie, je pensais qu'en France, j'allais me sentir plus en sécurité. Je pensais que ça allait être plus facile pour moi par rapport à la langue. Le Gabon est une ancienne colonie française.
Mais je ne connaissais personne en France.
Nous sommes arrivé.e.s le 18 décembre 2023, à Paris.
Mon fils m'a demandé : « Et maintenant, on fait quoi ? » Je ne savais pas. La première nuit, nous sommes allé.e.s dans un hôtel à Paris. J'ai communiqué avec une amie française au Gabon sur Facebook et elle m'a conseillé d'aller à Orléans. Je me disais que la France est un pays de droits : j'irai à la police, je leur expliquerai et ils nous aideraient. Je n'avais tué personne, je n'avais rien fait de mal.
Nous sommes resté.e.s toute la journée à la gare d’Orléans dans le froid. On avait faim. On est resté.e.s jusqu'à ce qu'on nous accompagne à l’association Coallia pour faire la demande d'asile. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit que ce n'était pas la peine d'aller à la police. Il fallait appeler le 115, un numéro pour l'hébergement d'urgence, où nous sommes resté.e.s pendant des mois. On a eu un rendez-vous pour aller à la Préfecture. On a été orienté.e.s à Bourges en mars 2024.
« Je voulais récupérer ma véritable identité »
Pour sortir du Gabon, j'avais dû partir avec une fausse identité. Mon « conjoint » – je déteste dire mon conjoint, c'est plutôt mon bourreau – était officier dans l'armée de Terre. Je ne pouvais pas partir avec ma véritable identité, j'aurais été reconnue tout de suite. J'avais donc un document d'emprunt.
Mais en arrivant ici, en France, je voulais récupérer ma véritable identité, celle qui est sur l'acte de naissance de mon fils. Ça a été difficile : à la Préfecture, ils ont cru que je mentais. C'est l'OFPRA, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, qui a finalement reconnu mon identité, à partir de mon récit et de preuves.
A Bourges, on a été accueilli.e.s en CADA (Centre d'Aide pour les Demandeurs d'Asile) en mars 2024. On a eu un appartement dans un quartier de Bourges, avec trois chambres, pour trois femmes avec trois enfants. Les assistantes sociales m'ont aidée à inscrire mon enfant à l'école. La directrice m'a dirigée vers des associations pour participer à la vie du quartier. Parce qu'en tant que demandeur d'asile, on n'a pas le droit de travailler.
La première association, c'était « C'est possible autrement ». Pendant quelques mois, j'ai repris des cours de français. Je le parlais mais j'avais des difficultés avec l'écriture. Au Congo, j'avais suivi l'école en pointillés. Chez nous, l'école est payante. Pour y aller, je devais économiser. J'ai quand même passé le bac mais j'avais plus de 25 ans parce qu'il y a eu beaucoup d'interruption dans ma scolarité. Mais j'étais très volontaire. Grâce à « C'est possible autrement » à Bourges, je suis entrée au « Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs » (RERS) pour les activités parents-enfants. Je suis devenue adulte-relais pour pouvoir aider d'autres parents étrangers à suivre l'école, notamment via les outils numériques. Je fais du bénévolat à l'école de mon fils : par exemple, j'accompagne les classes durant les sorties scolaires (piscine, cinéma...).
« Trouver un logement, suivre une formation, travailler... »
Il y a quelques semaines, j'ai obtenu le statut de réfugiée, ainsi que mon fils. Les étoiles ! L'espoir ! On a crié, on a pleuré d'émotion, on a fait la fête !
Les prochaines étapes, c'est : trouver un logement, suivre une formation et me lancer dans le monde du travail !
Dans ma tête, c'est comme s'il y avait une maison avec des chambres : dans l'une d'elles, il y avait l'angoisse de devoir retourner au Gabon ou au Congo, et dans une autre, il y a la perte de tous les êtres chers. J'aimerais qu'ils soient encore là. Il y a aussi la chambre de pouvoir retrouver ma fille.
Ce qui me manque le plus du Congo, c'est ma famille, ma mère. Je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille. Je n'ai pas non plus retrouvé ma fille. Je ne sais pas à quoi elle ressemble.
Du Gabon, c'est la chaleur humaine à laquelle je pense. Les gens sont très gentils : ce sont des Gabonaises qui m'ont aidée à arriver jusqu'ici. Et il y a la mer, qui est belle.
Mais ici, en France, je me sens plus en sécurité. J'ai l'espoir. Je resterai reconnaissante.
Propos recueillis par Isamiztli, Thierry et Fanny
Notes
- (1) https://gecamines.cd/
- (2) Le conflit date des années 1992-1993, sous le régime finissant du président Mobutu. Cette épuration ethnique baptisée Opération Bilulu (Insectes), a été menée contre des personnes appartenant aux groupes ethniques d’origine kasaïenne, supposées soutenir l’opposant Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Plus de 100.000 personnes y ont trouvé la mort et 800.000 personnes ont dû abandonner leurs biens.
- (3) Président de la République gabonaise de 1967 à sa mort, en 2009.