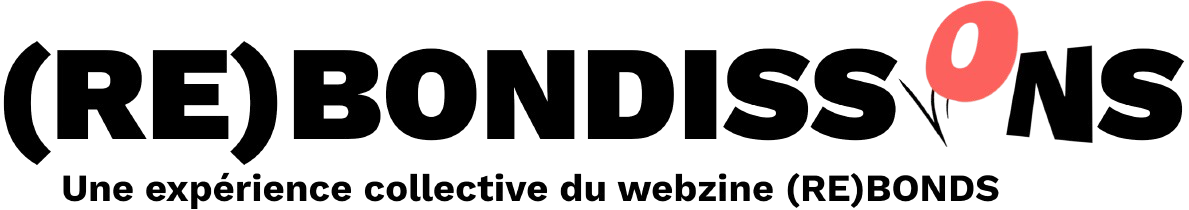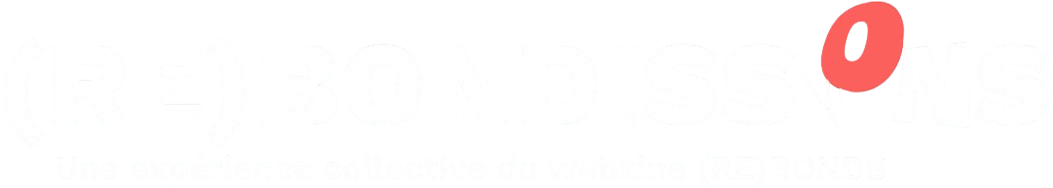L'Histoire de Bourges Nord par ses habitant.e.s - suite
Les témoins
Saadane Bensizerara - Arrive à la Chancellerie en 1967 à 8 ans, scolarité dans les quartiers Nord. Militant associatif depuis 1981, participe à la création du Centre associatif (1982) et de l’association El Qantara (1984). Animateur à la MJC Chancellerie (1982), chargé de la création de la Mission Locale pour les jeunes (1982). Intègre le Service jeunesse, l’équipe chargée du DSQ (1) des quartiers nord (1990). Service jeunesse (1997), chef de service en 2001. Centre Communal d’Action Sociale (2005) jusqu’à sa retraite (2021). Président d’Accueil et Promotion (2), vice-président du Centre associatif.
Jacques Caron, attaché de l’INSEE, statisticien à la Direction Départementale de l’Agriculture à Bourges, puis à Beauvais. Vit depuis 1972 à Evreux à La Madeleine, un quartier similaire à la Chancellerie. Poursuit ses engagements militants forgés à Bourges Nord, et comme élu adjoint au maire d’Evreux pendant quatre mandats. A écrit « Quartier brisé - Habitants spoliés » en 2010. Membre du collectif national Stop démolition.
Auguste Dorléans : éducateur puis directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Ministère de la Justice). Conseiller technique sur les questions de prévention spécialisée et contre la toxicomanie. Président départemental du Secours Catholique (2003-2009), président du Foyer de jeunes Travailleurs - Tivoli Initiatives (2011-2012). Membre d'associations d'accueil et accompagnement de demandeurs d'asile.
Renée Effa : école des Métiers d'Art (1952). Elle épouse Pierre Effa, trois enfants. La famille arrive de Lorraine en 1964, suite à la nomination de Pierre à La Poste de Bourges. Renée vit depuis 61 ans dans le même immeuble à la Chancellerie.
Joëlle Peaudecerf : éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée. S’engage à 18 ans à ATD Quart Monde (9 ans), puis à Emmaüs, et Solidarité Français Migrants. Choisit d’habiter Bourges Nord, en travaillant dans le social : éducatrice de prévention, directrice de halte-garderie en milieu semi-rural, éducatrice en milieu manouche à Vierzon. Fait partie de la Bibliothèque de rue, du Tourne-Livres, du Comité des habitants, du Centre associatif, de la Régie de Quartier. Donne aujourd’hui des cours de soutien en français à des personnes de l’immigration. Fait partie de l’habitat participatif La maison des Pourquoi Pas.
MAI 1968 - Renée
Tout manque au début. On installe les gens sans rien prévoir de plus que le strict hébergement. En mai, le temps est superbe, pas une goutte de pluie, tout le monde est inoccupé : pas d’école, pas d'essence, on ne peut pas se déplacer. Les magasins manquent de ravitaillement mais personne ne s'intéresse vraiment à la question des courses. Dans les nouveaux espaces verts, des bancs ont été installés. Comme il n'y a rien à faire, tout le monde se retrouve dehors, sur les bancs, on discute entre voisines. Pas d’hommes, que des femmes et des enfants. Beaucoup de maris travaillent chez Michelin : ils sont en grève, ils discutent dans les cafés. Au fond, dit Renée, c’est un peu comme maintenant : on aimerait bien être en grève, on en a marre de tout de qui se passe, que les pauvres ne soient pas considérés, de cette atmosphère méprisante qui vous rabaisse. Peut-être que la période actuelle va apporter quelque chose de différent : les Gilets jaunes ne sont pas arrivés par hasard. Ça s’est manifesté d’une autre manière mais les causes sont peut-être les mêmes : abus de pouvoir, mépris des gens, des plus pauvres surtout. Et puis des décideurs qui savent tout : ils n’habitent pas les HLM mais ils savent mieux que les habitants ce qu’il faut faire, ils pensent à leur place...
Renée reste assise, avec ses voisines, des semaines sur les bancs, à discuter. Les femmes se racontent leurs vies, d’où elles viennent, c’est comme ça qu’elles font connaissance. Pas d’heure pour se lever car rien à faire, elles ne sont pas pressées. Pas pressées de se coucher non plus. Mai 68, c’est un mois de rencontres, un mois chaleureux. En bavardant, les mamans surveillent les enfants qui jouent dans le bac à sable tout neuf, aménagé par les espaces verts de la Ville, et installé exactement au même endroit que celui de l’ « Opération Landau ». Elles n’évoquent pas les événements, au fond, elles s’en foutent.
1968 – Les procès contre l'Office des HLM - Jacques
En 1968, a lieu le procès contre l'Office des HLM. Les locataires paient le chauffage urbain à un prix beaucoup trop élevé car, explique Pierre Effa (7) au « Berry Républicain », le journal local : « on voulait faire payer aux habitants le coût de l’investissement [de la chaudière] » : celui-ci, imputé indûment aux locataires, ne pouvait pas être récupéré dans les charges locatives.
Un premier procès est perdu par l’avocat de la CGL (Confédération Générale du Logement) à Paris, et Pierre s’adresse à un avocat de Bourges, Maître Chantre, qui gagnera le procès en appel au début des années 1970. Mais, continue le Berry, « l’office décide de ne dédommager que les auteurs du procès ». Une centaine de tracts plus tard, un coup de fil de Raymond Boisdé, le maire, suffit à faire rembourser tous les locataires. Depuis, la question des charges d’entretien a pris le relais. La condamnation de Bourges Habitat par la justice n’a rien changé et d’autres procès sont à venir. Une attitude incompréhensible, et coûteuse pour l’office public. » (8)
Mais les bailleurs sociaux n’entendent pas se laisser faire. L’Union Sociale de l'Habitat (USH - les bailleurs sociaux), demande à son président, député, de faire modifier la loi, pour éviter une nouvelle déconvenue financière. Ce sera accompli par un « cavalier législatif » (9). Résultat : il n'y a plus égalité de traitement parmi les locataires des HLM :
- si le locataire occupe un logement individuel ou un appartement avec chaufferie dans l'immeuble, c'est le bailleur qui paie la chaudière et son remplacement éventuel ;
- mais si le locataire habite un logement avec chauffage urbain, il paiera pour les premiers l'investissement de la chaufferie dans ses charges locatives !
Cette décision (qui n’a pas fait l’objet d’un appel au Conseil d’Etat), pénalise à ce jour fortement les locataires des grands quartiers chauffés au chauffage urbain. A cette curiosité financière (incongruité ? injustice ?) s’ajoute celle du financement des extensions des réseaux de chauffage, conduites selon le même mode d’investissement. Les nouveaux clients sont exonérés de droit de raccordement, et ce sont les locataires des ZUP qui financent, à leur insu, l'investissement des chaufferies et leurs raccordements pour les nouveaux locataires dans leurs charges locatives !
Les locataires des grands ensembles sont ainsi fortement pénalisés, qui sont pourtant les locataires à faibles revenus. Cette loi pénalise, de plus, un mode d’urbanisme constituant des éco-quartiers potentiels. Il est regrettable que les députés, élus pour faire la loi, s’autorisent à la défaire au mépris de l’intérêt public.
1968-1972 – Les accidents - Renée, Jacques
Un des problèmes qui occupe les habitants très longtemps, c’est le manque total de signalisation routière dans le quartier, pendant la période des chantiers. C’est une question qui n’a pas du tout été pensée. Les camions roulent comme des fous, sans faire attention. Ce sont surtout eux qui ont causé les accidents. A cette époque, une dizaine d'enfants sont accidentés. Vers 1970, Vianney Effa, le fils de Renée et Pierre, est percuté par une voiture qui roule trop vite alors qu’il sort de la voiture de ses parents sur le parking de l’immeuble. Il est projeté sur le capot du chauffard. Son visage devient violet. Les pompiers le conduisent à l’hôpital, les médecins craignent que sa rate n’ait éclaté. Il a été sauvé, mais on a eu très peur, dit Renée, et on n’a pas été les seuls.
Les accidents augmentent avec le rythme des constructions, entraînant le décès de deux enfants. Après l'accident du petit Farhid Bourmada, 3 ans, le 25 août 1969, rue Charles-Péguy, survient le décès le 21 juillet 1970 du petit Alain, 3 ans, tué par un camion rue des Frères-Michelin : le Syndicat des locataires se réunit en urgence. On passe la nuit à rédiger un bulletin pour en informer les habitants du quartier. Il est tiré à la ronéo et distribué dans toutes les boîtes aux lettres. En moins de 12 heures, l’association couvre les 4.000 logements du quartier.
Durant les jours précédant l’enterrement du petit garçon, le Syndicat se mobilise pour sécuriser le quartier. Rien n’est fait par les pouvoirs publics, les habitants ne sont pas entendus. Le jour des obsèques, à 16 heures, est organisée une marche/action qui réunit une centaine d’habitants. On peint au sol des passages piétons et on installe des pancartes « Attention aux enfants » sur des poteaux électriques. Une des pancartes se trouvait d’ailleurs toujours à sa place des années plus tard. La marche est relayée par « le Berry Républicain ». Quelques semaines après, les services de la mairie viennent repeindre les passages piétons et installent de vrais panneaux de signalisation. Un schéma d’aménagement de la contre-allée Gustave-Eiffel est même proposé. Le Syndicat est pourtant en relation régulière avec les services de la Mairie et de l’Office des HLM, mais il aura fallu cette action et sa couverture médiatique pour que des mesures soient prises concrètement par les pouvoirs publics… Les accidents s’arrêtent.

Comme toute chose, dit Renée, il est bon d’écouter ceux qui sont concernés. On attend trop longtemps pour comprendre qu’ils n’ont peut-être pas tort. C’est terrible de croire qu’on a raison quand on n’est pas concerné, mais c’est malheureusement la tendance de beaucoup d’organismes. C’est effrayant la bêtise des décideurs ! Que les gens concernés puissent avoir raison, c’est quelque chose qui ne leur vient même pas à l’esprit !
Années 70 – Les lieux de réunion - Jacques, Renée
Une loi de 1975 fait obligation aux constructeurs de logements sociaux de construire des lieux de réunion pour favoriser l’animation des grands ensembles. Mais ils peuvent y déroger en versant une somme aux collectivités pour construire des salles. Les petites salles (pour 50 ou 100 logements) ne sont presque pas utilisées : elles servent de garde-meubles aux bailleurs dans les cas d’expulsions. Les réunions des locataires se déroulent dans les halls des immeubles, dans les sous-sols, à côté des caves des locataires, sans sanitaire ni chauffage. A Bourges Nord, la contribution des bailleurs aux équipements sociaux a été regroupée pour réaliser des équipements plus importants, comme la salle des fêtes.
Renée se souvient de la vie intense dans son immeuble : les enfants dans les escaliers, les fêtes organisées dans les sous-sols. Les enfants repeignent les murs, descendent des chaises, organisent des spectacles. Les grandes filles Flavigny enseignent aux petits les pièces de théâtre qu'elles ont apprises à l'école. Renée se souvient de trois petits garçons déguisés en majorettes…
1969 – La plaine du Moulon - Bourges 1970 - Renée, Saadane
La plaine du Moulon était grillagée et classée en zone inondable. Des vaches y broutaient, parties peu avant l'action. Les enfants veulent aller y jouer. Un jour, quelqu'un coupe le grillage. On ne sait pas qui, mais l’information se répand très vite. On demande au maire Boisdé de donner l’accès à la plaine aux enfants. Très surpris de la détermination des habitants, Boisdé donne son accord.
L’année suivante, la Fédération des Oeuvres Laïques organise un grand événement sur la plaine du Moulon, Bourges 1970 : animations, constructions de cabanes et d'un pont sur le Moulon. On mène tambour battant des activités d’extérieur. Sont concernés tous les enfants qui habituellement jouent en bas des immeubles de la Chancellerie. A partir de cette expérience très appréciée se développeront plus tard les Terrains d’aventures.
Le Comité des fêtes - Jacques
Dans la nouvelle salle de la rue des Frères-Michelin, inaugurée le 14 juillet 1970, des bals sont organisés par le Comité des fêtes, le samedi soir, le dimanche midi et le dimanche soir. Ce comité, constitué d'élus du Conseil municipal, est une équipe d'amuseurs publics. L’organisation de ces bals permet aux élus de détourner les habitants de l’influence de Pierre Effa et du Syndicat des locataires : il faut bien, d’une manière ou d’une autre, distraire les habitants de leurs problèmes, ce qui dispense de les résoudre...
Le dimanche 2 mai 1971, une jeune fille de 18 ans, qui s’était rendue au bal du samedi soir avec son compagnon, est entraînée dans la plaine du Moulon, violée et assassinée. Son corps est retrouvé dans le Moulon. Le quartier se mobilise et le Syndicat des locataires organise, à la MJC, un débat avec un psychiatre : « il ne s’agit pas de refaire une enquête mais de réfléchir sur les causes des troubles qui peuvent perturber la personnalité des individus fragiles, et les amener à un acte irréparable » (10). Le quartier réussit à faire le deuil de cette jeune fille, sans les traces de racisme qu’il pouvait redouter. L'enquête remontera au responsable (11).
1970/80 - Les terrains d'aventure - Saadane

Au tournant des années 80 démarrent les Terrains d’aventures qui dureront une vingtaine d’années : activités d’extérieur pour les enfants dans la plaine du Moulon, puis au parc paysager des Gibjoncs, constructions de cabanes, de ponts sur le Moulon... Saadane y intervient comme animateur en 1982. Comme lors de Bourges 1970, sont concernés les enfants qui jouent en bas des immeubles de la Chancellerie. On tentait ainsi de les motiver à participer aux activités des Centres de loisirs. Les Terrains d’aventures seront finalement supprimés par le maire Serge Lepeltier. (12)
Aux origines du Hameau de la Fraternité - Saadane
Les associations du quartier occupent longtemps des locaux vétustes et souterrains, dans les caves des immeubles. Elles commencent à se fédérer pour planifier leurs activités dans le cadre du Centre associatif. Elles occupent, au début des années 80, avec l’accord de la mairie, une ancienne école en préfabriqués, rue Louise-Michel, l’école des Merlattes. Plusieurs groupes s’y installent : les Portugais, Marocains, Tunisiens, Haïtiens, Vietnamiens, et le groupe des Jeunes amis des animaux. C’est un lieu de rencontres, de bienveillance et de convivialité.
En 1981, les jeunes du quartier organisent, de leur propre chef, le nettoyage de la plaine du Moulon. En récompense de leurs efforts, le maire Jacques Rimbault (13) leur accorde l'accès aux locaux de l’école des Merlattes.

1982 – Le Centre associatif et la Mission locale - Saadane
Le Centre associatif de la Chancellerie est créé en 1982 dans les préfabriqués de l’école des Merlattes avec Pierre et Renée Effa, Saadane Bensizerara (trésorier), Khader (secrétaire). Afin de créer une dynamique collective, le Centre se donne trois missions : mener à bien ses propres activités, animer les quartiers nord, gérer les salles municipales. L’accès aux locaux est d’abord gratuit. On organise un conseil de gestion mensuel, l’accueil des nouveaux arrivants, des échanges réciproques, des actions collectives. L’entretien des locaux est assuré bénévolement par Hassen Sioud de 1982 à 1989. La ville paie l’électricité.
On organise les festivités du 13 juillet, un feu d’artifice dans la plaine du Moulon, les Terrains d’aventures. On inaugure la première salle de prière du quartier, pour en finir avec « l'Islam des caves » (14). La structure est autonome et autogérée. Renée Effa sera la première présidente du Centre associatif.
En 1982 également, Saadane créé la Mission locale avec Marguerite Renaudat. Sa mission est d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans pour les aider à construire leur avenir : un lieu d'accueil, d'écoute et d'information. En 1982-83, une fresque est réalisée par un artiste peintre chilien, Dagoberto Monsalve, sur les anciens préfabriqués.

1983 – Naissance de Chants et danses du Maghreb - Renée
En 1983, un petit larcin est commis par des fillettes qui s'ennuient ferme, et ont peu de jouets pour s'amuser. Renée Effa organise un goûter : les petites filles doivent restituer ce qu'elles ont pris, mais aussi expliquer ce qu'elles veulent faire pour remédier à leur ennui. L’une d’entre elles rêve de faire du spectacle. Renée en parle à Pierre, qui pense au spectacle de danse contemporaine de Elhadi Cheriffa (15) à la Maison de la Culture, dans le cadre des Rencontres internationales de danse contemporaine. Pierre propose au maire que le chorégraphe réalise une intervention dans les quartiers nord auprès des jeunes. Elhadi Cheriffa accepte volontiers. Une vingtaine d'enfants s’inscrivent, surtout des filles au début. Une première rencontre a lieu en juillet, financée par la mairie, qui engendrera un premier spectacle dans la cour du Centre associatif. Les mamans confectionnent les costumes.
1984 - Le mois pour l'égalité et contre le racisme de Bourges - Saadane
En février/mars 1984, Saadane, Hamadi et Nourredine, créent le « Collectif pour l’égalité et contre le racisme de Bourges » et organisent le Mois éponyme, avec le Foyer des Jeunes Travailleurs : exposition, participation à la marche Bourges-Sancerre, soirée débat « La France : société multiraciale ? », tournoi de foot opposant des équipes du FJT (16), de l’IUT, de l’AMITAG (DOM-TOM) et des Algériens de Bourges, constituent de belles mobilisations. Le mois se termine avec le Festival interculturel dans la salle des fêtes de la Chancellerie : musiques et danses de Syrie, du Portugal, de Turquie, du Sud-est asiatique, d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, et du Berry.
Dans ce cadre, Elhadi Cherriffa, grâce à une subvention de la ville, revient une quinzaine de jours en février pour une formation auprès des enfants de « Chants et danses du Maghreb ». Elhadi et Pierre font du porte à porte dans le quartier, et recrutent une cinquantaine d’enfants : un spectacle de danses traditionnelles du Maghreb sera ainsi créé et présenté devant 1.000 personnes dans le tout nouveau Palais des congrès de Bourges. La femme d’Elhadi donne des cours de chant aux enfants. L’année suivante, le spectacle sera présenté dans des écoles du quartier, au Centre Régional de la Chanson, au jardin de l’Archevêché, à la Maison pour tous de la Chancellerie.
1984 – Création de l'association Chants et danses du Maghreb - Saadane
« Chants et danses du Maghreb » était une section du Centre associatif. En 1984, l’association éponyme est créée, avec l’appui des associations communautaires : Algériens, Marocains, Tunisiens, Français Musulmans Rapatriés. A partir de février 1984, Kheira Hadjeres, danseuse de Modern Jazz, fait le suivi des cours de danse des petits de Cherriffa. Lahcen Kacim s'occupe des grands, mais aussi des cours de percussions, et gère la partie musicale des spectacles. La particularité des cours de Lahcen Kacim : avant les cours de danse, il fait courir les enfants dans la plaine du Moulon, et leur fait faire des abdos.
Elhadi Cherriffa revient l'été suivant, en juillet 1985, puis une dizaine de jours deux fois par an, jusqu'en 1994, pour travailler avec les enfants. Dans un premier temps, la ville finance, puis Saadane obtient une subvention auprès du Secrétariat d’Etat aux Rapatriés, via l'Association des Français-Musulmans rapatriés.

En mai 1985, est présentée au Théâtre Jacques-Coeur, pour le centenaire de la mort de Victor Hugo, une chorégraphie créée par Pierre-André Effa (17) (textes) et Lahcen Kacim (chorégraphie), avec l’aide du conseiller d’éducation du collège Victor-Hugo, « Les Djinns » (18), qui rencontrera un très grand succès public. Une tournée sera organisée pour le spectacle à Mehun-sur-Yèvre, Vierzon, Saint-Florent-sur-Cher, Saint-Pierre-des-Corps, Beauvais, Rennes, Châtellerault, Pithiviers, Grenoble, Orléans, Tours, Macon, Forbach... Ces tournées sont gérées par Kheira et Lahcen : une cinquantaine d'enfants, une dizaine d'adultes (costumières, encadrants, metteurs en scène) pour les accompagner. En 1987, « Les Djinns » font l’ouverture du Printemps de Bourges au Palais des Congrès, largement salués par 2.000 personnes.
C’est une époque où l'interculturel est très développé, les associations ont un peu d'argent, d’importants réseaux culturels se mettent en place, à travers des MJC, des centres sociaux, des municipalités de gauche. Kheira Hadjeres suggère à Pierre Effa de créer une section chants et musique au sein de l’association. En février 1987, Rachid Guerbas, musicien spécialiste de la musique arabo-andalouse, vient à Bourges pour un premier stage de deux jours avec les enfants. En novembre 1987 est créée la classe de musique arabo-andalouse de Rachid au Conservatoire de musique de Bourges.
Rachid a également créé le groupe de musique arabo-andalouse « AlBaycin », qui rayonne par ses concerts au Palais Jacques-Coeur de Bourges, mais aussi à Nice, Nanterre, Corbeil, Douai, au Musée Delacroix, au Grand Palais, au Centre Culturel Algérien et à l’Ambassade de Belgique à Paris, en Algérie, Maroc, Allemagne, Espagne, Autriche...
1989 – Création du Hameau de la fraternité – Saadane
De 1984 à 1988, afin de répondre à la demande des associations dont les locaux sont inadaptés, exigus et dégradés, le maire Rimbault engage la construction du Hameau de la Fraternité. Il désigne un architecte, Francis Ohayoun, pour une mission de chantier libre : l’architecte travaille pendant un an en coopération avec les associations et le Hameau ouvre ses portes en janvier 1989.
Cette même année, a lieu « Par les chemins du temps », une création chorégraphique collective de danse contemporaine, conçue à partir des propositions des jeunes danseurs et danseuses de « Chants et danses du Maghreb » (chorégraphie d’Elhadi Cherriffa, musique de Lahcen Kacim). Elle est présentée en avant-première au MacNab à Vierzon, puis part en tournée en Algérie, au Théâtre Régional de Bejaia, à la Maison de la Culture de Setif, et dans la salle Ibn-Kaahdoun à Alger. Elle sera présentée à Bourges à la MCB en novembre 1989.

1989 – Le contrat de développement social des quartiers (DSQ) et autres séquences - Saadane
Le DSQ est un dispositif mis en place en 1982 sous la présidence de François Mitterrand. Le maire de Grenoble est missionné pour identifier les difficultés dans les quartiers et crée une commission. Les premières villes candidates sont Dreux et Les Minguettes. Bourges se porte candidate en 1989, et un contrat est signé pour les quartiers nord. Pierre-André Effa, le fils de Pierre et Renée, qui travaille au service de l’urbanisme, et Saadane au service Jeunesse, rédigent ensemble le dossier. Ils obtiennent le label DSQ qui ouvre droit à des crédits spécifiques de l'Etat et de la Ville. Chaque année, ils présentent un appel à projet : Atelier théâtre des Gibjoncs, Comité des habitants, Régie de quartier, Chants et danses du Maghreb...
En 2011, sous le maire Serge Lepeltier (19), la ville récupère la gestion des salles municipales, et retire au Centre associatif le droit de les gérer en autonomie.
En avril 2015, un des quatre bâtiments du Hameau est détruit par un incendie. Pour assurer la poursuite des activités des associations, la mairie engage la rénovation d'un bâtiment scolaire désaffecté aux Merlattes, à proximité du Hameau, qui deviendra les Locaux associatifs des Merlattes, rue Henri-Moissan.
En mai 2018, les statuts du Centre associatif sont modifiés pour acter un changement de gouvernance : la Ville ne souhaite plus être présidente de droit. Puisqu’elle gère en direct les locaux depuis 2011, cela n’avait plus de sens. Le président et les membres du bureau ne sont désormais plus recrutés parmi les élus municipaux.
Notes
- (7) Le 11 février 2013 : https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/il-prend-les-renes-de-lunion-amicale-des-locataires_1439158/
- (8) Ibidem.
- (9) Un cavalier législatif est un article de loi qui introduit des dispositions qui n'ont rien à voir avec le sujet traité par le projet de loi. Ces articles sont souvent utilisés afin de faire passer des dispositions législatives sans éveiller l'attention de ceux qui pourraient s'y opposer.
- (10) Le Berry républicain, sans date connue.
- (11) https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Tissier
- (12) Maire de 2005 à 2014.
- (13) Maire de 1977 à 1993.
- (14) Les prières dans les sous-sols.
- (15) Chorégraphe et directeur de la compagnie Transdanse.
- (16) Foyer des Jeunes Travailleurs.
- (17) Le fils de Pierre et Renée.
- (18) D’après le texte de Victor Hugo (1829).
- (19) Note 12.
Plus
Le premier épisode est disponible ici : https://rebonds.net/webzine/revisiter/L-histoire-de-Bourges-Nord-par-ses-habitant-e-s-183/