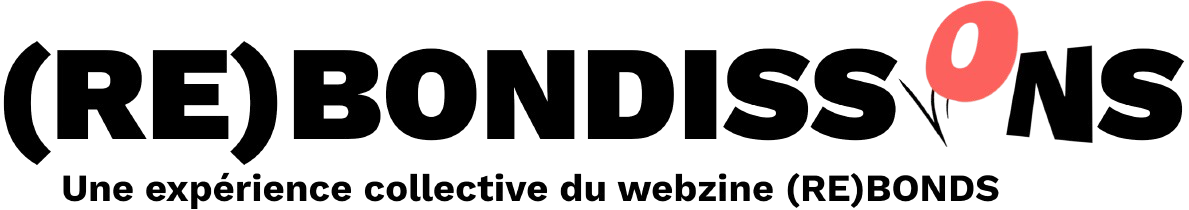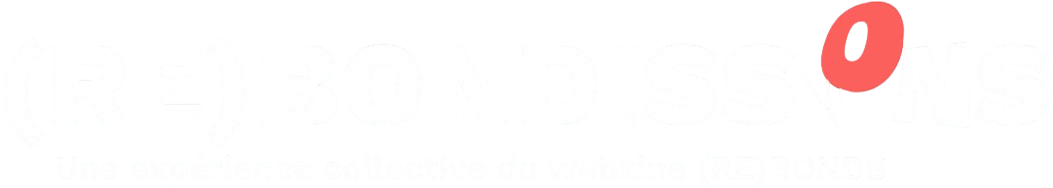Interview d'Aude Emilie Dorion, journaliste en Kanaky Nouvelle-Calédonie
Pouvez-vous vous présenter succinctement ? (prénom, nom, année et lieu de naissance, fonction)
Aude Emilie Dorion, 1980, Blois, journaliste, photojournaliste / reporter.
Si vous militez dans un mouvement politique et / ou citoyen, pouvez-vous préciser lequel ? Comment vous placeriez-vous sur l'échiquier politique ?
En tant que journaliste, je m'accroche aux principes fondamentaux de la déontologie, ces règles qui font de notre métier un pilier de la démocratie. Malgré les muselières croissantes et les risques toujours plus grands dans de nombreux pays, où la quête de vérité se heurte à la censure et aux menaces, je crois fermement que notre force réside dans la responsabilité de délivrer une information équilibrée. Pas de place pour les opinions personnelles qui pourraient fausser la présentation des faits ou les prises de position politiques faussant l'intégrité des analyses.
Pourtant, cet engagement envers l'objectivité ne m'empêche pas de pencher plus volontiers vers la défense des droits de l'homme et de l'environnement. Deux causes intrinsèquement liées tant la dégradation de notre planète frappe de plein fouet les populations les plus vulnérables. Après 13 années passées dans le Pacifique Sud, une des régions justement les plus exposées au réchauffement climatique, je m'efforce de donner une voix à ceux qui sont ignorés ou marginalisés. Quand certains créneaux de publication me l'autorisent, j'en profite pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, pour produire ou vulgariser des données utiles permettant de mieux comprendre ces enjeux.
Cet engagement se traduit par des échanges constants avec des scientifiques, des militants et les communautés. C'est à travers ces dialogues que le journalisme joue, à mon sens, son meilleur rôle : celui de catalyseur pour le changement. Dans les sociétés démocratiques, c'est un quatrième pouvoir au service de la société. A l'inverse, l'absence de médias indépendants et pluralistes peut mener à une perte de transparence et de responsabilité. C'est ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, où, faute de presse écrite quotidienne, il devient difficile de cultiver le libre arbitre, l'action collective ou la possibilité de tenir les responsables pour compte.
Pour quels types de médias travaillez-vous (journaux, magazines, radios, tv, sites Internet...) ?
J'ai travaillé dans des rédactions de presse quotidienne régionale et nationale en Thaïlande, en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique Sud, ainsi que pour divers magazines. J’ai également rejoint il y a une dizaine d’années le réseau Earth Journalism, une communauté mondiale dédiée au journalisme environnemental.
En Nouvelle-Calédonie, le paysage médiatique a connu de profonds bouleversements ces dernières années. La disparition des Nouvelles-Calédoniennes, unique quotidien local, a creusé un vide dans la couverture de l’actualité, réduisant la pluralité des voix et des points de vue accessibles aux citoyens. Résultat : une concentration des médias entre les mains d’acteurs institutionnels ou politiques, ce qui pose un vrai défi à l’objectivité et à la liberté d’informer. En dehors de France TV, de rares médium indépendants peinent à exister, la presse restante est souvent liée à des institutions publiques, à des partis, limitant leur capacité à questionner les pouvoirs en place. Une réalité difficile à vivre pour un journaliste, mais surtout préoccupante pour la vitalité du débat public calédonien qui s’appauvrit en l’absence d’une presse pluraliste et critique.
Côté thématiques, je me passionne pour la recherche, la pêche et l’extraction minière — trois secteurs clés de l’économie mondiale qui soulèvent des enjeux de durabilité, de droits des communautés et de préservation des modes de vie traditionnels. La pêche industrielle, avec ses menaces sur les ressources halieutiques et les écosystèmes marins, est au cœur de mes préoccupations. De même, l’extraction minière, souvent source de conflits et de déstabilisation des communautés locales, m’intéresse particulièrement. J’attache une grande importance à donner la parole à ces populations, à mettre en lumière leurs luttes pour protéger leurs terres et leurs traditions, tout en explorant les efforts des industriels pour adopter des pratiques plus responsables, ainsi que les cadres réglementaires qui tentent de concilier enjeux socio-économiques et environnementaux.
Enfin, sur le plan économique, je m’intéresse aux dynamiques sous-jacentes à ces industries et aux nouveaux modèles alternatifs - comme l’économie circulaire ou les pratiques agricoles et commerciales équitables - qui cherchent à allier développement économique et respect de l’environnement.
Avez-vous suivi la révolte de 2024 ? Si oui, quel regard portez-vous sur les événements d'alors ?
Les émeutes qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie ont révelé un malaise profond, mêlant tensions sociales, économiques et politiques, le tout autour d’un sujet brûlant : la composition du corps électoral. Le fameux « dégel » qui a embrasé le pays - cet élargissement du droit de vote aux élections locales à des résidents non autochtones voté à 20.000 kms après les résultats contestés du troisième référendum - par une partie de la population calédonienne qui a perçu cette loi comme une vraie menace pour sa représentation et sa souveraineté. Pour la population kanak, surtout les jeunes, cette mesure a ravivé un sentiment d’injustice et de marginalisation. Sans prendre parti, je peux vous dire que, concernée par cette réforme, je n’aurais probablement pas emprunter ce chemin pour y parvenir ! Ça a été une énorme faute politique de la part de l'Etat et ça en dit long aussi sur la classe politique calédonienne, mais j’y reviendrai un peu plus bas...
En mai dernier, entre drapeaux français et kanak flottant dans les rues, le territoire semblait plus divisé que jamais. Après la nuit du 13 mai et les mois qui ont suivi, des ingérences étrangères ont fait leur apparition, dévoilant des enjeux géopolitiques et économiques bien plus complexes qu’on ne le pensait. Intox, désinformation sur les réseaux sociaux, cyber-attaques... les règles du jeu ont changé. C’est dans ce contexte que j’ai commencé à creuser un sujet intitulé « Réchauffement climatique : folie des hommes vs montée des eaux ». Il s’intéresse aux tensions autour de l’exploitation minière en eaux profondes dans le Pacifique Sud, et aux dilemmes auxquels font face les Etats et territoires insulaires, entre financements internationaux, zones de pêche et d'extraction convoitées et zones économiques exclusives. A la veille de l'UNOC3, sans pointer du doigt ni dénoncer, mon but était d’ouvrir le débat sur ces nouveaux équilibres à trouver entre écologie, économie, autonomie locale et dynamiques globales. Parce que ces territoires ne sont pas que des points sur une carte : ce sont des lieux de vie, de culture, de résilience, en première ligne face aux dérèglements climatiques.


Comment avez-vous vécu personnellement cette période (sensiblement mais aussi à travers votre métier) ?
Il y a une énorme déception à voir disparaître 40 ans d'accords uniques dans l'histoire de la (dé)colonisation, et qui auraient pu servir de modèle pour d'autres pays en quête d’autonomie. Cette période rappelle aussi les profondes inégalités sociales qui persistent, notamment au sein de la population mélanésienne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 80% des Kanak occupent des emplois peu rémunérés, contre 45% pour le reste de la population. En matière d’éducation, 49% des Kanak âgés de 15 à 64 ans n’ont aucun diplôme qualificatif, contre 33% pour les non-Kanak. Et en prison, 90% des détenus sont Kanak.
Depuis les accords de Matignon en 1988 et de Nouméa en 1998, des politiques de « rééquilibrage » ont été mises en place pour tenter de réduire ces inégalités, mais les progrès avancent lentement. L’histoire de la Nouvelle-Calédonie est marquée comme l'Algérie par une histoire coloniale de peuplement avec, comme vous le rappellez très bien dans votre rétro, une spoliation foncière dès 1853, lorsque la France a pris possession de l'île. Les autorités coloniales ont créé des réserves pour les Kanak, tout en favorisant l’installation de colons libres ou d'anciens bagnards, limitant ainsi leur accès à la terre et à ses ressources. Aujourd'hui, les enjeux fonciers sont aussi teintés de revendications économiques liées à des investissements dans les mines, l’agriculture ou le tourisme. Mais qui décide de l'utilisation des terres et qui en profite vraiment ? La complexité du mille-feuille institutionnel en Nouvelle-Calédonie complique souvent la résolution de ces conflits fonciers. Depuis 1978, des réformes ont tenté de reconnaître les droits fonciers kanak et de redistribuer les terres de manière plus équitable, mais le chemin reste semé d'embûches.
Il est aussi essentiel de mentionner que l'économie locale est dominée par quelques familles influentes qui contrôlent des secteurs clés tels que le commerce, l'immobilier et les mines. Ce petit groupe détient un pouvoir économique considérable, en fait il est en situation de monopole. Ce système est renforcé par des régimes de défiscalisation opaques. Sur le papier, ces programmes visent à encourager les investissements locaux, mais ils facilitent également la magouille et la fuite des capitaux. Pour (r)établir un équilibre social et économique, une réforme des politiques fiscales s'avére indispensable en Nouvelle-Calédonie qui navigue de ce point de vue dans des eaux troubles, entre inégalités et instabilité institutionnelle chronique.
En tant que journaliste, était-il facile de rendre compte de la situation ou avez-vous été empêchée (par exemple de vous rendre dans certains lieux, d'interviewer certaines personnes) ? Que ce soit par les forces de l'ordre ou les révolté.es ?
Selon vous, quelles traces ces événements ont-ils laissé dans la société calédonienne (d'un point de vue économique mais aussi moral, politique et social (relationnel) ?
Je n’ai pas couvert les émeutes, un choix personnel face à ce chaos. J’ai senti que ma place à ce moment-là était auprès de mon enfant. Quand l’état d’urgence est déclaré, c’est qu’il n’y a plus de règles dehors. Pour les confrères, c’était casque et gilet pare-balle pour couvrir l’info et passer les barrages. En bas de chez moi dans un périmètre restreint, nous étions relativement préservés car militants indépendentistes de la CCAT et voisins souhaitions préserver le centre de dialyse (la dialyse en Nouvelle-Calédonie est un enjeu de santé publique important), un des seuls à ne pas avoir cramé. Dans les quartiers proches de la Conception et de Saint-Louis, c’était la guerre, le Raid, les explosions et les cris chaque soir. Tout cela va laisser des traces et nous sommes tous un peu post-trauma actuellement. J’ai été extrêmement touchée par la xénophobie qui s’est réveillée pendant ce conflit, notamment à travers les groupes de vigilents qui se sont constitués dans chaque quartier. Je me suis rendue compte en les cotôyant que des gens installés en Nouvelle-Calédonie depuis des décennies ne connaissent pas les Kanak, ne se sont jamais intéressé à eux, à leur culture et/ou à leurs traditions séculaires. Les propos racistes et les discriminations, souvent banalisés, ont trouvé un terreau fertile dans un climat de tension et de méfiance mutuelle, c'était affligeant de bêtise et d'ignorance. Un concept raciste autour de l'homme noir reposant sur des stéréotypes et des préjugés a commencé à (re)faire surface de manière extrêmement choquante.
Ça fait mal et c’est tellement loin des valeurs que j’ai pu approcher en vivant ici. Je donnerai pour exemple la coutume de bienvenue, une pratique traditionnelle importante et toujours bien vivante dans la culture kanak et qui veut dire en langue « je me présente devant toi et tes ancêtres pour m’autoriser à fouler ce sol ». L’histoire contemporaine de ce beau pays est à des années lumière de cette approche anthropologique de l’Autre, et nous avons tant à apprendre de ces coutumes ancestrales...
Manuel Valls, le ministre de l'Outre-mer, a relancé le processus de discussion entre indépendantistes et loyalistes, sans toutefois parvenir à un accord. Quelle ambiance régnait sur l'archipel lors de ses différentes visites ?
Diriez-vous que ce processus a tout de même permis des avancées ? Selon vous, les discussions ont-elles une chance de reprendre, y compris sous une autre forme ?
Le projet de souveraineté dans la France peut être une occasion de rassembler les communautés autour d'un avenir commun, d'une identité propre et inclusive, cela aurait le bénéfice de transformer les blessures du passé en nouvelles opportunités pour des communautés multiples. En Nouvelle-Calédonie il n'y a pas que des Kanak et des Européens, il y a des Indonésiens, des Vietnamiens, des Chinois, des Wallisiens et Futuniens, des Polynésiens, etc.. C'est un territoire métissé où la majorité des gens aspirent à une paix durable, et surtout à sortir d'une situation politique et institutionnelle bloquée depuis trop d'années dans un marasme politique rythmé par les tensions clivantes entre indépendantistes et loyalistes. Rappelons que ces clivages occupent tout le débat politique, ne laissant que trop peu de place aux enjeux géostratégiques régionaux qui se dessinent. La France, représentée par Manuel Valls héritier d'une approche de négociation à la Rocard, a tout intérêt à envisager une indépendance-association pour la Nouvelle-Calédonie.
Pourquoi cela ? D'abord, parce que cette (dé)colonisation est inscrite dans les accords, peu importe comment on l'interprète. Ensuite, parce qu'il il faut garder à l'esprit que la présence française dans l'Indo-Pacifique passe par ses territoires d’Outre-mer, comme La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, et Wallis-et-Futuna, qui lui confèrent une immense ZEE, la deuxième plus grande au monde.
Et puis, parce que cette instabilité politique de l’archipel est un vrai sujet de préoccupation pour les puissances voisines comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout cela se déroule en même temps sous les yeux du monde, puisque la Nouvelle-Calédonie figure sur la liste des territoires à décoloniser à l’ONU. Le modèle d'indépendance-association, observé dans plusieurs pays du Pacifique Sud, offre une voie intermédiaire entre souveraineté totale et dépendance, permettant à ces territoires de gérer leurs affaires tout en bénéficiant d’une aide sur les compétences régaliennes souvent hors de portée financièrement pour ces petits états.
Cependant, ce qu’on remarque après les visites du ministre des Outre-mer, c'est la virulence des loyalistes, qui ne se gênent pas pour critiquer à la fois les indépendantistes et la France, bien que cette dernière leur apporte actuellement un soutien financier extra-ordinaire. Quand des élus se permettent de tenir des propos incendiaires par voie de communiqué ou de tutoyer des ministres sur les réseaux sociaux, on se demande quand les Calédoniens chercheront à renouveler - enfin - leur classe politique...
Dans le même temps, il est important de souligner que durant ce conflit, des personnalités émergentes, tant dans la société civile que sur la scène politique, méritent d'être entendues. Prenons Luther Voudjo, par exemple, docteur en droits des finances publiques. Voici une personne qui pourrait contribuer à redresser le territoire en menant un grand ménage fiscal... Au fond, si la Nouvelle-Calédonie voulait embrasser pleinement la situation actuelle, elle rassemblerait toutes ses forces vives - quel que soit leur bord politique - pour élaborer un projet de société plus juste, plus égalitaire et surtout plus ancrée dans son océanité.
Quelle est la situation actuelle en Kanaky Nouvelle-Calédonie, notamment économique et sociale ? Diriez-vous que des tensions persistent et si oui, comment se manifestent-elles au quotidien ?
La situation est difficile, les gens n’ont plus d’argent, pas ou peu de travail et les mesures engagées par le gouvernement actuel avec le concours du MEDEF et des Chambres consulaires ne font que redéployer et encourager un système qui nous a conduit tout droit vers les évènements de l’année dernière. Avec la faim et la misère, une certaine forme de violence s’installe également : braquages de magasins et cambriolages de maisons, bref les gens ont faim et l’inflation actuelle n’aide pas les choses dans un pays ou environ 70 à 80 % des produits alimentaires consommés sont importés, de France hexagonale, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
Est-ce que l'archipel se fracture ou des ponts demeurent-ils entre les populations ?
Les "ultras" de tous bords sont à présent en minorité, mais les conséquences de leurs actions pèsent lourd et contrairement au message des loyalistes sur ces émeutes, les responsabilités sont partagées. Avec près de 900 entreprises et 200 maisons détruites, ce sont environ 7.000 emplois qui se sont volatilisés, représentant plus de 10 % de l’emploi privé de l'île. L'économie locale est sérieusement touchée, mais ce n'est pas tout : cette crise a creusé les fossés entre les communautés, alimentant une méfiance croissante et une division clairement palpable.
Les services de santé, déjà sous pression, souffrent maintenant d’un manque de personnel inquiétant. Cette désertification médicale a des effets dramatiques sur l’accès aux soins pour la population. On assiste à une pénurie croissante de professionnels de santé, notamment des médecins généralistes comme de spécialistes, surtout dans les zones rurales et aux îles. Les raisons de cette désertification sont multiples : vieillissement de la population médicale, manque d'attractivité des zones éloignées, et surtout énormes difficultés à recruter de nouveaux praticiens après les émeutes. Les conséquences sont sérieuses : les délais de consultation s’allongent, les services d'urgence sont saturés et dans certaines communes, notamment du Nord, ils sont fermés par manque de personnel.
Les autorités locales et les acteurs de la santé essaient de mettre en place des mesures pour attirer et retenir les professionnels, mais jusqu'à présent, les résultats sont timides. De plus, la vague de départs suite aux émeutes prive peu à peu la Nouvelle-Calédonie de certaines compétences, rendant encore plus difficiles les efforts pour rétablir l'équilibre socio-économique.
La route vers la reconstruction, tant physique que sociale, s’annonce longue et compliquée. Elle nécessitera des efforts concertés mais pour l'instant, nous n'assistons qu'à une polarisation croissante des débats politiques.
Sonia Backès, présidente de l'assemblée provinciale du sud, a envisagé une séparation des provinces et a déclaré que "le destin commun a échoué". Est-ce que sa proposition a des chances d'aboutir ? Comment cela a-t-il été reçu localement ?
Sonia Backès a proposé un modèle de fédéralisme pour la Nouvelle-Calédonie, une idée qu'elle a présentée comme un moyen d'apaiser les tensions politiques et sociales qui agitent le territoire. Elle appelle cela une « autonomisation des provinces », s'inspirant d’un fédéralisme à l’américaine pour donner plus d'autonomie aux provinces. Suites aux émeutes, des mesures controversées ont été prise en province Sud autour de l'accès à l'aide médicale notamment et aux bourses scolaires. Une proposition et des applications déconnectées de la réalité dans ce contexte de crise. Au lieu de rassembler, cette approche accentue un peu plus des divisions déjà très marquées.
Cette provincialisation - outil historique à vocation de rééquilibrage - est aujourd'hui perçue par de nombreux calédoniens comme un frein à la croissance économique du territoire. Avec moins de 300.000 habitants, multiplier les dépenses publiques par trois semble être en effet une recette idéale pour un désastre financier.
Les déclarations clivantes de Sonia Backès tout au long de cette année pourraient bien de toute façon lui coûter une partie de son électorat lors des prochaines élections provinciales ; des élections qui seront à suivre avec beaucoup d'attention.
Le transfert et l'incarcération des membres de la CCAT dans l'Hexagone, ainsi que de dizaines de prisonniers de "droit commun", ont-ils fait l'objet d'une médiatisation conséquente sur l'archipel ? Si oui, qu'en ont dit les médias locaux ? En parlent-ils encore ? Avez-vous le sentiment que la population suit cela de près ?
Les discussions autour de la légitimité et des conséquences des transferts de détenus continuent de faire débat en Nouvelle-Calédonie. Les médias locaux ont beaucoup relayé le transfert de sept membres de la CCAT, dont leur leader Christian Tein, vers des prisons de l’Hexagone. La CCAT a dénoncé cette action comme une déportation et une parodie de justice, et de nombreux Calédoniens se sont indignés, la qualifiant d'arbitraire et appelant au retour des détenus sur l'archipel.
Du côté des indépendantistes, ce transfert a été considéré comme un relan de pratiques coloniales. Pour certains, la décision de dépayser le dossier a été perçue comme une tentative de centralisation du processus judiciaire. Pourtant, cela a permis une gestion plus sécurisée et impartiale des affaires, même si des questions sur les droits des accusés et les implications humaines liées à ces transferts, (éloignement géographique, absence de couverture sociale, et obstacles financiers) ont été soulevées, la justice opère sur un temps long. Dans l'attente du jugement, ce dépaysement semble surtout garantir une certaine impartialité dans le traitement du dossier des membres de la CCAT, qui sont depuis quelques jours sortis de détention provisoire et assignés à résidence dans l'Hexagone.
Y a-t-il des mobilisations organisées par des collectifs et / ou des familles, afin de sensibiliser sur le sort des prisonniers ? Si oui, sont-elles bien suivies ?
Oui, la mobilisation est toujours présente dans les familles et en tribu mais les rassemblements ont été interdits pendant de très nombreux mois sur l’archipel et dans un contexte économique et social tendu, les gens restent chez eux.
Vous travaillez sur des sujets qui articulent traditions et modernité. Ce que fait également Guillaume Vama (détenu pendant près d'un an à Bourges) dans une certaine mesure. Y a-t-il beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens en Kanaky ?
La Nouvelle-Calédonie est avant tout un pays rural, où les cultivateurs et pêcheurs vivent en harmonie avec les cycles de la nature. Prenons par exemple Guillaume Vama, qui se bat pour promouvoir l'autonomie alimentaire et l'agroforesterie sur l'archipel. Ce sont des concepts essentiels pour garantir la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale de ce territoire fortement dépendant de l'importation.
Un des enjeux actuels pour la Nouvelle-Calédonie est donc clairement de produire suffisamment de nourriture pour réduire cette dépendance alimentaire à l'importation estimée à 70-80 % de sa consommation. Avec ses écosystèmes uniques et une biodiversité riche, l'archipel a tout ce qu'il faut pour développer ses capacités d'autonomie alimentaire en encourageant l'agroforesterie, les connaissances sur les plantes traditionnelles comestibles, l'aquaculture, etc. Des initiatives locales et des programmes de recherche, notamment avec l’Institut agronomique néo-calédonien font justement la promotion de ces pratiques qui reposent en substance sur une vision assez simple : diversification des cultures et mise en place de réseaux de distribution cohérents permettant de désenclaver la chaine (côté Est et îles Loyauté).
Ici, et plus particulièrement dans ce contexte de crise, il devient même urgent de diversifier l'économie et de développer des industries durables. L'archipel a par exemple un potentiel énorme pour les énergies renouvelables, ainsi que pour le tourisme écologique. Ces secteurs pourraient réduire la dépendance au nickel, créer de nouveaux emplois et améliorer la résilience économique du territoire.
Sur le volet énergétique, le Costa Rica fait souvent office de modèle de transition réussie, en produisant aujourd'hui presque toute son électricité à partir de sources renouvelables, mais cela s'est fait grâce à des politiques publiques audacieuses. La Nouvelle-Calédonie a elle aussi tout le potentiel pour opérer ce virage, surtout compte tenu de sa taille de population. Malheureusement, le manque de courage de sa classe politique pourrait bien freiner des ambitions partagées par de nombreux citoyens pour une transition verte en Nouvelle-Calédonie. Les objectifs récemment fixés par sa politique de transition énergétique ne sont, quoi qu'il en soit, pas atteignables tant que la Nouvelle-Calédonie ne révisera pas sa politique de favoritisme énergétique pour l'industrie du nickel.
Colonisée par la France mais d'histoire océanique, et dans un contexte de monde globalisé, comment se nourrit la culture calédonienne aujourd'hui ? Où la jeunesse va-t-elle puiser ses inspirations ?
L’héritage de la colonisation française marginalise la Nouvelle-Calédonie dans la région Pacifique. Le français, langue officielle, constitue une barrière linguistique avec les autres nations du Pacifique, majoritairement anglophones. Cela peut donner l'impression que la Nouvelle-Calédonie est un peu "orpheline" dans sa région, à l'écart des dynamiques économiques, culturelles et politiques des autres îles.
Pourtant, malgré cette barrière, l'archipel partage beaucoup de similitudes culturelles et historiques avec ses voisins océaniens. Les échanges et les collaborations régionales aident à atténuer cette distance linguistique, contribuant à une intégration progressive de l’archipel dans le tissu océanien.
La jeunesse calédonienne, de plus en plus connectée et ouverte sur le monde, joue un rôle clé dans ce rapprochement. Grâce à des initiatives souvent éducatives et culturelles, les liens se renforcent. Cependant, il reste selon moi encore beaucoup de chemin à parcourir pour vraiment établir des connexions solides avec les autres territoires océaniens.
Interview : Fanny Lancelin et David Clary
Crédit photos : Aude Emilie Dorion
Plus
Pour aller plus loin, Aude Emilie Dorion conseille :
- South Pacific: Global warming, human’s folly vs rising waters par Aude-Emilie Dorion
- Le pays du Non dit de Déwé Gorodé : un recueil de poèmes et de textes qui explore les thèmes de l'identité, de la mémoire et de la résistance kanak.
- "Océanie les peuples du pacifique" de Jean Guiart : une étude anthropologique des différentes cultures océaniennes, leurs traditions et leurs évolutions contemporaines.
- Etat d’urgences, féroces de Paul Wamo : des textes écrits à Tahiti, pendant la crise. Des textes mémoires pour ne pas oublier.
- Les excellentes chroniques de Jean-Michel Guiart : auteur qui écrit sur divers sujets liés à la Nouvelle-Calédonie, notamment sur les conflits, l'identité culturelle, et les enjeux politiques et sociaux de l'archipel. Des écrits disponibles sur son blog Mediapart.
- Le documentaire "Éloi Machoro, itinéraire d'un combattant" explore la vie et l'héritage d'Éloi Machoro, une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
- Portes de fer, un documentaire d’Alan Nogues. À la croisée des récits intimes et des scènes de chaos, le réalisateur capture l’embrasement de Nouméa et de son quartier, témoignant d’un conflit aussi brutal qu’imprévu.
- Les indépendances avec partenariat des pays insulaires autonomes du pacifique Sud de Mathias Chauchat, Université de la Nouvelle-Calédonie
- Le jour où Paris connaîtra les vertus du talanoa par Sylvain Dern
- Laurent Chatenay