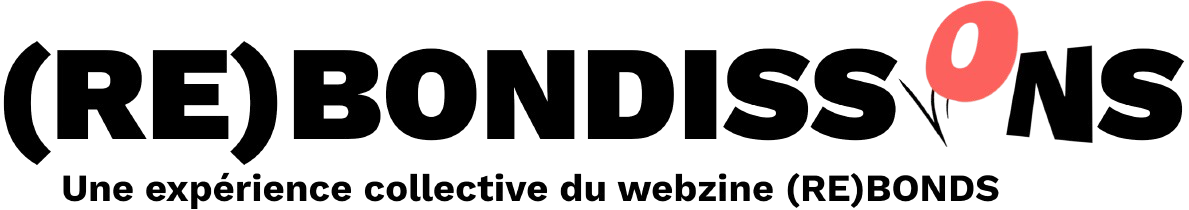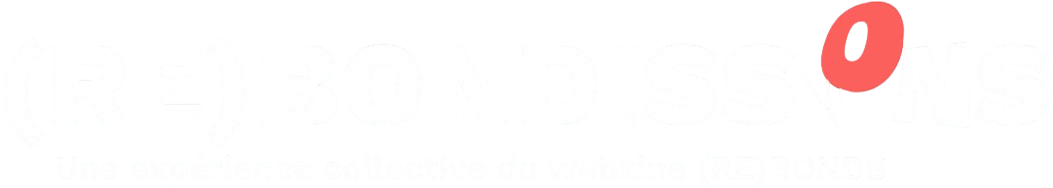Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, même quand on fait la fête !
Avec l’arrivée du printemps et de l’été, arrivent également les festivals, les fêtes sur la plage ou dans les bars, les fêtes chez soi ou dans des lieux collectifs. Ce n’est pas seulement de la musique, des rires, de la danse, des retrouvailles. Pour beaucoup de femmes ou de personnes non cis genres, cela implique aussi très souvent de prendre des précautions particulières : toujours être au moins deux, recouvrir son verre, utiliser des codes pour communiquer en cas de danger, se censurer vestimentairement en espérant ne subir ni remarque, ni comportement non désiré... Mais lorsque l’on est dans un festival, par exemple, qui brasse énormément d’êtres humains, ces précautions peuvent devenir dérisoires.
Des femmes ont décidé de réagir. C’est ainsi qu’en 2020, Festivités Fight Sexisme (FFS) a vu le jour : un protocole de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. FFS a également pour but de « soutenir divers lieux et collectifs organisant des événements festifs pour y limiter les risques d’agressions sexistes et sexuelles, et réagir en cas de problème ».
En s’inspirant de ce qui existait déjà, il répond à quatre objectifs :
- sensibilisation (notamment au consentement) via des prises de paroles, de l'affichage, un infokiosque, parfois une bibliothèque féministe et un espace de détente en mixité choisie ;
- veille via un numéro d’urgence, la tenue d’une permanence d’accueil et d’écoute, des membres en maraude avec des signes reconnaissables et qui peuvent être sollicité·e·s à tout moment ;
- formation des recrues à une culture dite féministe et au protocole en lui-même ;
- riposte en cas d’agression (c’est-à-dire concentration des bénévoles pour soutenir, accueillir, écouter la personne victime d’agression et identification, intervention auprès de la personne coupable d’agression).
Il s’agit d’un protocole d’urgence, ce qui ne permet pas un accompagnement sur le long terme des personnes victimes et actrices de violences, mais elles sont orientées vers des organismes spécialisés. Le protocole est également transmis à d’autres collectifs et d’autres lieux associatifs organisateurs de soirées et d’événements.
Un cadre juridique insuffisant
Mais pourquoi est-ce aux personnes concernées, aux bénévoles, aux associations et collectifs de faire ce travail alors qu’il existe un cadre juridique en France sur la question ?
Paradoxalement, avec de nombreuses lois concernant les violences sexistes et sexuelles, apparaît le mythe de « l’égalité déjà-là ». Ce mythe est construit sur la croyance d’une égalité au sein de la population puisqu’il existe un cadre juridique dit égalitaire, ayant pris en compte le combat de féministes qui ont porté leurs voix depuis des décennies pour faire entendre les violences et injustices patriarcales et sexistes. Mais, si l’Etat et la justice sont aussi investis dans la pénalisation des violences, pourquoi existe-t-il encore autant de collectifs actifs sur la question et surtout, pourquoi est-ce que les chiffres de personnes portant plainte pour agression sexiste ou sexuelle n’ont pas drastiquement chuté ?
C’est parce que ces mesures théoriques (juridiques) ne sont pas suffisantes. Ce n’est pas la pénalisation qui permet de réduire les risques et ce n’est pas non plus la pénalisation qui permet l'avènement d’un consensus social visant à mettre un terme aux inégalités de genre sur tous les plans de la vie (sexuel, professionnel, culturel…). Il suffit d’observer les procédures judiciaires en cours de quelques ministres hommes cis qui exercent dans la politique en ce moment même, pour comprendre que le cadre juridique n’assure pas une égalité de fait. Les accusations de viols et de harcèlements sexuels sont nombreuses et cela n’empêche pas d’être dirigeants d’un pays. Cela donne plutôt à voir l’impunité des comportements de violences sexistes qui assure pour les personnes agresseuses de n’être pas inquiétées.
Pour preuve, trois questions simples : combien de personnes victimes de violences sexistes et sexuelles connaissons-nous ? Combien de personnes coupables d’agressions connaissons-nous ? Et combien ont dû répondre de leurs actes devant la justice ? On peut trouver des pistes dans les témoignages et les chiffres. Sur le site de NousToutes, on peut notamment lire que « plus d’une femme sur deux en France (53 %) et plus de six jeunes femmes sur dix (63 %) ont déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle au moins une fois dans leur vie ». Alors que seulement 12 % de ces personnes ont porté plainte. Une fois cette plainte déposée, presque 80 % des affaires ont été classées sans suite (en 2021). Il est alors facile de comprendre que nous côtoyons, voire même aimons, tous et toutes des personnes ayant été victimes d’agression (dont beaucoup qui n’en parlent pas) et des personnes ayant agressé qui ne sont pas identifiées (2).
Le cadre juridique n’est en fait qu’un leurre et ne permet en aucun cas une égalité de fait. Soit ses mises en application sont inexistantes (comment porter plainte dans le cadre d’un harcèlement de rue, on porte plainte contre qui exactement ?), soit elles sont insatisfaisantes (comme l’indique l’enquête menée par #NousToutes, début mars 2021, qui a recueilli 3.500 témoignages en quinze jours, montrant la violence sexiste qui persiste au sein même des lieux de justice et d’accueil comme les commissariats) (3).

Un protocole spécifique dans un contexte plus dur
Si l’été appelle à la fête, le contexte politique en France appelle aux manifestations depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c’est également FFS qui est à l’origine d’un autre protocole : Riot Fight Sexism (RFS). L'objectif : adapter le protocole à des événements militants où les participant·e·s risquent de se confronter à la répression policière.
Mettre un tel protocole en place dans un but de réduction des risques en milieu festif fait sens, mais pourquoi en milieu militant ? Le milieu militant est un milieu souvent plus éveillé et conscientisé aux questions d’inégalités et de domination, mais il persiste, comme partout, des habitudes et comportements oppressifs. On peut évidemment se retrouver sur une manifestation contre l’accaparement de l’eau ou contre la réforme des retraites tout en étant traversé·e par le sexisme ou le racisme, pour ne parler que de ces deux oppressions. Les comportements oppressifs peuvent être réfléchis et parfaitement décidés, comme ils peuvent également être intériorisés et inconscients. C’est ce qu’on appelle les violences systémiques : c’est au sein même du système que l’on retrouve ce qui est à l’origine et ce qui alimente les oppressions.
Avril fait partie des équipes qui ont mis en place FFS et RFS. Elle travaille sur la thématique des violences de genre depuis 2019 et rappelle « la banalité des violences sexistes ». C’est pourquoi, même en milieu associatif et / ou militant, il est essentiel de faire de la prévention. Pour les membres de ces protocoles, l’idée n’est pas d’instaurer « une surveillance mais plutôt d’apporter quelque chose en plus, comme une attention, un soin porté aux unes et aux autres. »
Pour les membres de RFS et de FFS un des enjeux importants est également « de visibiliser que ce genre de violences traversent tous les milieux », et que ça n’a rien à voir avec « la sphère de l’intime ». En effet, considérer que les violences dans le cadre d’un couple ou d’une famille, c’est une question de vie privée ou d’intimité, c’est passer à côté du rôle de la société sur ces comportements, de l’importance d’en parler pour réaliser le nombre de personnes qui en sont victimes et de comprendre que ce n’est ni intime ni privé car l’oppression est systémique.
Nous avons croisé RFS une première fois en octobre 2022 et une deuxième fois en mars 2023, à chaque fois pour les manifestations contre les méga-bassines (4). En mars 2023 (5), c’est donc une mise en place d’un protocole plus spécifique qui a été réfléchi, « car le contexte festif est différent quand il fait suite à une manifestation où les participant·e·s sont victimes de répressions policières », explique Avril.
Mais dans les grandes lignes, RFS ressemble à FFS. Les quatre objectifs de sensibilisation, veille, formation et riposte sont les mêmes. Des stands et des membres en maraudes identifiables sont également présent·e·s et un espace sécurisé permettant d’accueillir au calme les personnes victimes d’agressions est installé.
Un appel à la responsabilité collective
Environ une centaine de personnes ont été formées à tenir le protocole à Nantes, Rennes, Paris, La Rochelle, Grenoble, Poitiers, Clermont-Ferrand et en visio (ce qui représentent environ 30 heures de formation). Ayant eu l’opportunité de participer à l’une d’elles, j’ai constaté une approche très féministe. En effet, il est répété inlassablement que la posture des bénévoles se doit d’être soutenante pour les personnes victimes de violences. Ses propos sont toujours écoutés, jamais remis en question et ce sont ses besoins qui ont la priorité. Concernant les personnes autrices de violences, plutôt qu’une approche punitive, c’est à une possibilité de changement, de réparation et de prise de conscience qu’il faut croire. Deux approches qui sont parfaitement opposées à ce que l’on retrouve dans la justice et dans la société.
RFS (ainsi qu’FFS) appelle aussi à une responsabilité collective, à une bienveillance entre toutes les personnes présentes sur site. Avril explique qu’iels essayent également « d'avoir une influence sur le collectif organisateur pour que ça se diffuse sur l'ensemble de l'événement. Par exemple, on invite les bénévoles (au bar notamment) à s'autoriser à réagir à des propos sexistes ; on demande aux facilitateur·ice·s des conférences et discussions d'avoir une attention sur la répartition de la parole et les propos discriminants ; on cause aux artistes pour qu'iels s'autorisent à nommer des choses dont iels seraient témoins pendant leur show ; on sensibilise aux questions de genre pour que les affichages de l'événement ne soient pas ciscentrés, etc ».
C’est une approche essentielle car elle pousse à prendre conscience que les inégalités et violences de genre concernent en réalité toute la population et qu’à notre échelle, nous avons tou·te·s un rôle important à jouer, que cela soit par la prévention, le soutien, l’éducation ou encore la révolte et la désobéissance. Mais elle dit aussi que la responsabilité collective ne permet plus une mise à distance du problème, et ouvre la porte à la déconstruction des violences systémiques.
Ce qui est également très marquant avec ce protocole RFS, c’est l’importance donnée à l’amour et la protection. L’amour porté aux autres, bien sûr, mais aussi à soi, car intervenir dans ce genre de protocole peut renvoyer à des événements vécus personnellement. Il est d’abord rappelé qu’il ne s’agit pas de nous et qu’il est important de ne pas prendre la place émotionnelle de la personne victime d’agression. Mais, si l’on se trouve submergé·e et alors incapable d’intervenir, il est rappelé de penser à soi et de s’écouter, pour pouvoir aussi se protéger soi-même.
Il est difficile d’avoir le comportement idéal dans ces situations, mais écouter, être là et vouloir faire quelque chose est déjà exceptionnel.
Texte : ophelie
Illustrations : Heartempowerments ; PicElysium
Notes
- (1) C’est-à-dire que l’on croit les propos de la personne agressée et qu’à aucun moment on ne les remet en doute.
- (2) Chiffres tirés du site https://fr.statista.com/statistiques/1373886/part-affaires-violences-sexuelles-classees-sans-suite-france/
- (3) https://www.noustoutes.org/enquetes/
- (4) Une méga-bassine est une retenue d’eau artificielle, alimentée en pompant directement dans la nappe phréatique, pour arroser de grandes cultures, principalement du maïs en France. Les méga-bassines menacent les ressources en eau. Elles sont le théâtre d’une opposition forte menée par les habitant·e·s des régions concernées mais aussi plus largement par le mouvement écologiste et donnent lieu depuis quelques années à des manifestations massives, comme à Sainte-Soline, en mars dernier.
- (5) 25 et 26 mars 2023 : manifestation à Sainte-Soline contre un nouveau chantier de méga-bassines. Elle a été durement réprimée par les forces de police. A ce sujet, voir le rapport de la Ligue des Droits de l’Homme rendu public le lundi 10 juillet 2023 : https://www.ldh-france.org/empecher-lacces-a-la-bassine-quel-quen-soit-le-cout-humain-2/
Plus
- Retrouvez et / ou participez à l’organisation de RFS ou FFS cet été : du 3 au 6 août au Larzac pour Les Résistantes 2023 ; du 26 août au 3 septembre à Bure aux rencontres paysannes. Vous pouvez les contacter via ce mail : ffscrew@riseup.net
- D’autres festivals affichent leur objectif de réduction des risques et ont une politique plutôt stricte sur la question. C’est le cas du Hadra Trance Festival, qui écrit sur son site : « La lutte contre le harcèlement et les violences de genres ou sexuelles s’est largement étendue et nous sommes conscient·e·s que ces comportements et agressions existent partout, même dans nos fêtes. Depuis 2018, l’association Hadra renforce ses actions en matière de bienveillance et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. ». En effet, le festival a mis en place une Team Inaya visant à maintenir la bienveillance au sein du festival, à prévenir des violences et à intervenir en cas d’agression.
Citons également le festival Au foin de la rue qui a une politique de réduction des risques très importante et qui a mis en place la formation d’équipes accompagnées par Les Catherinettes une association militant contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif et partenaire de la campagne « Ici c’est cool ! »
Citons enfin l’association Bouillon Cube qui s’engage à lutter contre les violences sexistes et les discriminations lors de ses événements, afin que ceux-ci puissent être les plus accueillants et bienveillants possibles pour les personnes qui y participent (public, bénévoles, salarié·e·s, artistes, partenaires…). Pour cela depuis 2021, iels portent un projet autour de la prévention des violences sexistes et sexuelles en milieu festif rural : le KIF – Kit Inclusif et Festif.
- Un exemple à ne pas suivre ? Le Hellfest qui a été le terrain d’agressions sexuelles déclarées en 2013 et 2019, avait choisi une approche dramatiquement banale, de remise en question des propos de la personne victime d’agression. Une posture qui avait suscité la polémique. Il semble que le protocole d’accompagnement ait, depuis, été modifié...